Les « pingers » et autres avertisseurs sonores peuvent-ils aider à réduire le risque de collision entre bateaux et cétacés ?
Des milliers de cétacés meurent de collisions avec des navires. De nombreuses mesures de protection sont mises en place, mais leur efficacité n’est pas toujours démontrée.

Des milliers de cétacés meurent chaque année de collisions avec des navires. De nombreuses mesures de protection sont mises en place, mais leur efficacité n’est pas toujours démontrée, à l’instar des « pingers », ces « effaroucheurs sonores » dont on ne connaît pas les effets sur les animaux et le reste de l’écosystème marin.
Cette année, l’organisation du Vendée Globe a demandé aux concurrents d’éviter les zones protégées pour réduire les risques de collisions avec les cétacés — des grands cachalots aux baleines à bosse, en passant par les baleines grises. Certains bateaux sont même équipés de « pingers », des dispositifs d’effarouchement sonore qui visent à éloigner les animaux des navires. Déjà utilisés par certains bateaux de pêche, notamment dans le golfe de Gascogne pour éviter les prises accidentelles de cétacés dans les filets, leur utilisation dans la prévention des collisions entre navires et cétacés est moins documentée.
À l’heure actuelle, l’efficacité des pingers n’est pas démontrée par la recherche. Si l’idée peut sembler bonne, elle soulève différentes questions. Les pingers ne représenteraient-ils pas pour les cétacés une nouvelle forme de « pression » humaine ? Les 90 espèces y réagissent-elles toutes de la même manière ? Les animaux pourraient-ils s’habituer à ces « ping » sonores sous-marins au fil du temps, réduisant de facto leur efficacité à les effaroucher ?
Utilisés en combinaison avec d’autres mesures de gestion du trafic maritime — limitation de la vitesse dans des zones de forte abondance de cétacés par exemple — et optimisés pour limiter leur empreinte nuisible sur les animaux et l’environnement marin, les pingers pourraient aider à réduire les collisions entre navires et cétacés, qui tuent des milliers de cétacés chaque année et qui seraient responsables de près de 30 % des décès chez certaines espèces menacées, comme la baleine noire de l’Atlantique Nord.
Comment les collisions sont évitées aujourd’hui
Le risque de collisions est amplifié dans les zones de forte densité de cétacés et de trafic maritime important. Au-delà des accidents mortels, les collisions entraînent des blessures graves, du stress et des perturbations comportementales qui tous, participent au déclin global de populations de cétacés.
À lire aussi : Les cétacés sont menacés par des collisions dues au trafic maritime, pourtant des solutions existent
Pour les éviter, outre les mesures de contournement de zones protégées et de réduction de la vitesse des navires, il faut développer des solutions immédiates comme la formation des capitaines et des personnels à bord de la marine marchande, et continuer à développer les nouvelles technologies comme les outils de détection visuelle et acoustique en temps réel.
De plus, des études scientifiques permettent également d’identifier des zones sensibles, à fort risque de collision.
Le bruit ambiant peut empêcher les baleines d’entendre un navire à l’approche
Alors que l’acoustique est la modalité sensorielle de prédilection utilisée dans la vie des cétacés, le brouhaha sous-marin généré par les activités humaines — dont le trafic maritime — masque en partie les sons produits par ces mammifères marins. Ceci diminue les capacités de ces derniers à communiquer avec leurs congénères, à trouver leurs proies, à détecter la présence de prédateurs, et à identifier d’autres dangers, comme un navire à l’approche. Par exemple, les baleines à fanons sont dotées d’une sensibilité auditive basse fréquence 15Hz-20kHz, correspondant globalement à notre bande auditive mais avec une meilleure performance dans les infrasons — ces performances doivent normalement leur permettre d’entendre les gros navires.
Malgré cela, il semble que ces grands cétacés aient des difficultés à détecter et à anticiper l’approche d’un navire et qu’ils ne parviennent pas à l’éviter. Nous y voyons plusieurs raisons.

[Plus de 120 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Dans une zone de fort trafic maritime, la capacité à détecter acoustiquement un navire parmi le bruit des autres est réduite. Mais d’autres facteurs semblent aggraver le problème, et en particulier la vitesse de circulation des navires, bien plus élevée que celle de ces grandes baleines. Le déplacement des baleines à bosse dans leur aire de reproduction, par exemple, se fait en moyenne à 2 nœuds. Sans parler du temps qu’elles passent en position statique, comme lors des phases de repos.
De plus, la variation des propriétés de propagation acoustique dans la colonne d’eau (notamment proche de la surface) et de la directionnalité des bruits des bateaux (plutôt orientée vers la poupe) pourraient rendre difficile la localisation du navire, et une potentielle habituation au bruit continu du trafic maritime pourrait réduire la vigilance des baleines à l’approche de navires.
Dans une volonté de réduire la pollution sonore générée par l’activité humaine en mer, le développement de bateaux de plus en plus silencieux vise à réduire l’impact du bruit… mais on peut se demander s’il ne va pas, dans un malheureux effet secondaire, augmenter le risque de non détection des navires par les baleines et donc les collisions.
À lire aussi : Préserver les océans du bruit humain pour mieux les protéger
C’est ainsi qu’est arrivée l’idée d’utiliser des « pingers » : des dispositifs émettent des signaux sonores à caractère répulsif ou d’avertissement pour les animaux, initialement conçus pour prévenir les captures accidentelles de cétacés dans les filets de pêche et proposés plus récemment comme potentielle mesure préventive pour éloigner les animaux de zones à fort risque d’impact comme les chantiers éoliens par exemple, ou pour réduire les collisions avec les navires.
Dans ce dernier cas, le pinger serait déployé sur la coque des navires ou sur des bouées dans des zones de forte circulation maritime ; il génèrerait un signal sonore pour effaroucher les animaux ou les alerter de la présence d’un navire, les incitant alors à changer de direction avant qu’une collision ne survienne. Ces pingers pourraient être activés à distance ou automatiquement lorsqu’un navire entre dans une zone de risque avéré, identifiée par les autorités maritimes.
On manque de données pour savoir si les pingers sont efficaces pour éviter les collisions
Le manque considérable de recherches visant à tester de manière expérimentale l’efficacité des pingers ne permet pas, aujourd’hui, de trancher quant à la pertinence de leur utilisation.
Considérée par certains comme des klaxons qui ajoutent du bruit au bruit ambiant, ou comme une solution miracle par d’autres, l’utilisation des pingers et autres dispositifs sonores avertisseurs fait l’objet de débats.
Si quelques résultats scientifiques encourageants ont été obtenus (modification de la trajectoire des cétacés en s’éloignant du navire), d’autres n’ont décelé aucun effet bénéfique voire parfois une augmentation du risque de collision (attraction vers la source sonore, remontée soudaine du cétacé en surface).

Des questions demeurent également quant à leur impact environnemental, le bruit ayant des effets potentiellement nuisibles chez de nombreuses espèces — avec des répercussions à l’échelle des écosystèmes, et leur mise en œuvre à grande échelle.
Mis très (trop) tôt sur le marché, les pingers n’ont pas fait l’objet de suffisamment de tests pour démontrer expérimentalement leur efficacité. De plus, ils sont souvent fabriqués et utilisés de manière générique alors que leur conception devrait être pensée quasiment au cas par cas, en fonction de la sensibilité auditive de l’espèce visée, de son comportement, du contexte écologique (aires d’alimentation, de reproduction) et social (présence de jeunes, taille du groupe), des propriétés de propagation du son dans le milieu et des pressions environnementales naturelles et anthropiques (niveau et bande passante du bruit ambiant). D’un point de vue scientifique, il semble qu’un avertisseur sonore universel pour toutes les espèces de cétacés soit difficile à concevoir.
L’une des pistes pour améliorer l’efficacité des pingers tout en limitant leur impact serait de remplacer ou de combiner les signaux synthétiques classiquement utilisés à des signaux naturels (tels que des sons produits par l’espèce elle-même), potentiellement plus informatifs et avec moins d’empreintes sur l’environnement. Cela nécessite en amont un gros travail de recherche pour décrypter les systèmes de communication acoustique des différentes espèces de cétacés.
Nous menons actuellement en partenariat avec l’entreprise Greenov une étude pilote pour tester expérimentalement, sur le terrain, le pouvoir d’alerte d’un signal sonore chez les baleines à bosse dans une zone de reproduction, en amont de l’élaboration par l’entreprise d’un prototype d’avertisseur sonore à fixer sur la coque de navires. Ces expériences en mer sont complexes et nécessitent des protocoles stricts qui doivent être conduits par des experts scientifiques. Pour cela, nous réalisons des expériences d’exposition sonores contrôlées communément appelées « playback », et mesurons les réponses comportementales des baleines à bosse munies au préalable de balises multicapteurs déployées sur leur dos de façon non invasive au moyen de ventouses.
La conférence des Nations unies sur les océans qui se tiendra à Nice du 9 au 13 juin 2025, suivie de la conférence sur les collisions entre navires et cétacés le 16 juin 2025 à Brest, seront deux occasions de réunir les acteurs des autorités maritimes, ingénieurs et scientifiques, pour discuter collectivement des priorités de recherches à mener, et des solutions et mesures réglementaires à adopter.![]()
Charlotte Curé a reçu des financements de société greenov. Nous évaluons expérimentalement l'efficacité d'avertissement d'un signal sonore qui a vocation à être implémenté ultérieurement dans un prototype construit par la société greenov.
Loanne Pichot a reçu des financements de la société greenov afin d'évaluer expérimentalement l'efficacité d'avertissement d'un signal sonore qui a vocation à être implémenté ultérieurement dans un prototype construit par la société.
Isabelle Charrier et Olivier Adam ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.








![[LE CROC D’IXÈNE] Le ministre des Familles lance « Démographie 2050 »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/bv77-de-mographie-2050-vgn-516x482.jpg?#)


![[POINT DE VUE] Terrible constat : notre aviation de chasse tiendrait 3 jours](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2021/05/rafale-616x379.png?#)


































![[#Fridaynews 357] L’actualité Réseaux Sociaux de la semaine](https://swello.com/fr/blog/wp-content/uploads/2024/11/fridaynews-357.png)





























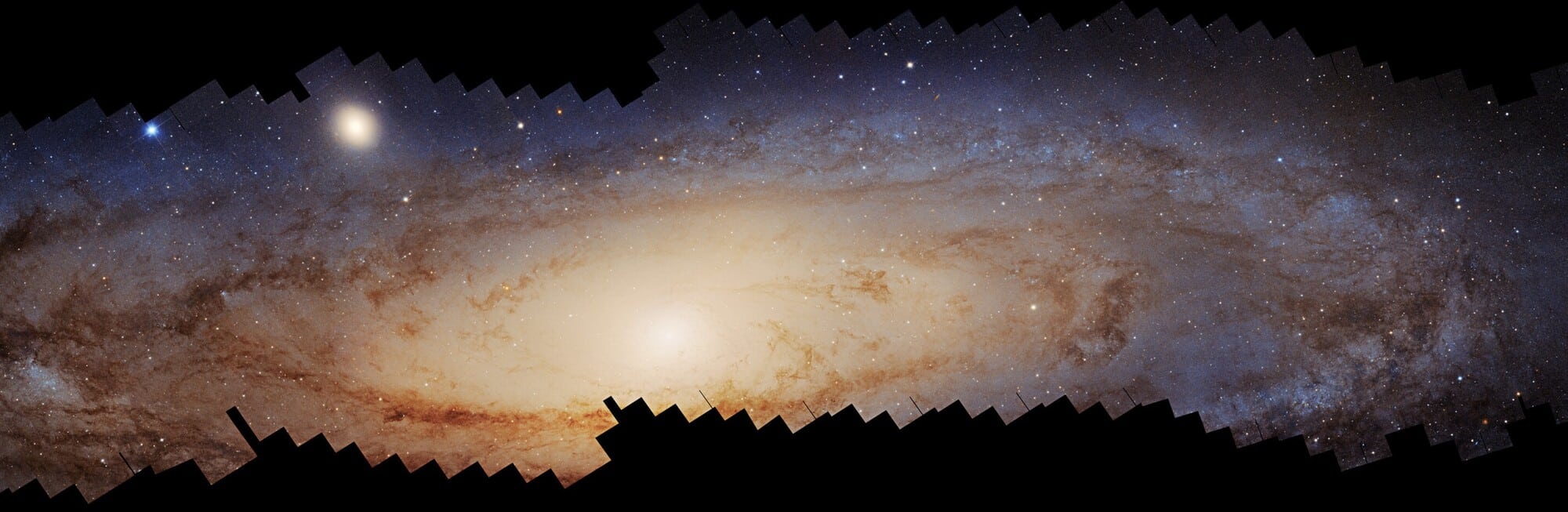
![Il n’y a jamais eu autant de cyberattaques qu’en 2024 : mais que font les entreprises ? [Sponso]](https://c0.lestechnophiles.com/www.numerama.com/wp-content/uploads/2024/09/fuite-de-donnees.jpg?resize=1600,900&key=5c92933b&watermark)