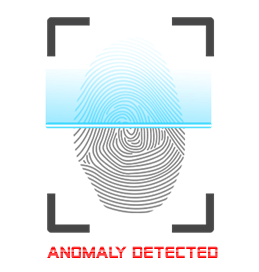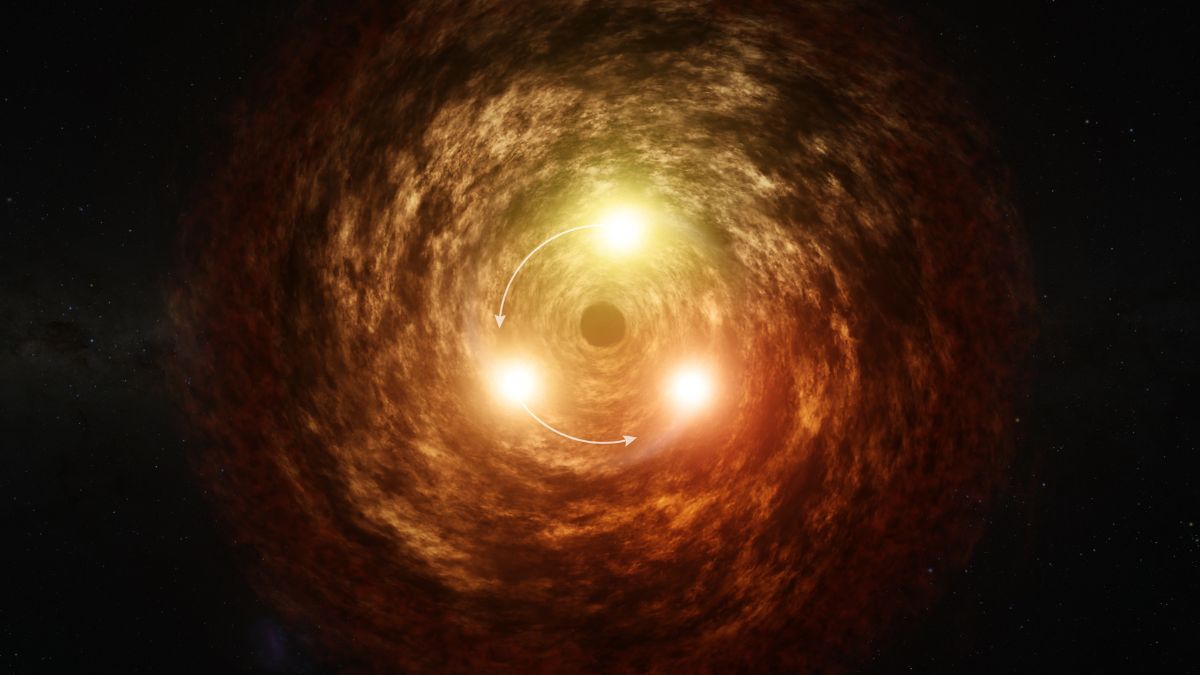Vaincre la Russie à tout prix, même celui de l’État de droit ?
À l'heure où la nouvelle administration Trump entre en fonction et que nous approchons du 3ème anniversaire de l'invasion de l'Ukraine et des sanctions massives introduites consécutivement, quels enseignements juridiques tirer des sanctions de l'Union européenne ?... L’article Vaincre la Russie à tout prix, même celui de l’État de droit ? est apparu en premier sur Causeur.

À l’heure où la nouvelle administration Trump entre en fonction et que nous approchons du 3ème anniversaire de l’invasion de l’Ukraine et des sanctions massives introduites consécutivement, quels enseignements juridiques tirer des sanctions de l’Union européenne ?
| Maître Étienne Épron est un avocat français spécialisé dans les fusions-acquisitions, le droit des sociétés et les sanctions internationales. Il a développé une expertise notable concernant la Russie, notamment en passant cinq ans au sein du cabinet Gide à Moscou et à Paris. Son cabinet, Épron Quievy & Associés, dispose d’une présence internationale, notamment à Moscou • |
Au-delà de la question de leur efficacité, il est un aspect des sanctions qui est passé sous silence, alors même qu’il engage nos valeurs : les sanctions, en particulier les sanctions individuelles, restreignent les libertés fondamentales de personnes désignées. Concilier la nécessaire protection des libertés fondamentales avec l’action politique de l’Union Européenne est un défi juridique de taille.
En matière pénale, les privations de libertés sont l’éventuelle conséquence d’un jugement rendu à l’issue d’une instruction détaillée – à charge et à décharge -, qui garantit le respect des droits de la défense et de la présomption d’innocence. Au cours de cette instruction, le prévenu peut accéder au dossier, fournir aux autorités des éléments de nature disculpatoire et être accompagné d’un avocat.
Tout au contraire, en matière de sanctions, il n’y a pas de jugement préalable à la privation de liberté, l’instruction étant remplacée par la seule volonté politique du Conseil de l’Union européenne assise sur des « dossiers de preuves » dont on ne sait trop comment ils sont constitués et dont le contenu est parfois contestable.
Notre expérience nous enseigne en effet que ceux-ci peuvent comporter des éléments peu fiables et orientés idéologiquement, pouvant être perçus comme arbitraires. Le Conseil de l’Union européenne n’hésite ainsi pas à assoir ses décisions sur des articles de presse issus d’obscurs sites internet tels que : www.russian-crimes.com, https://sokalinfo.com/, https://nowheretorun.org/, https://www.spisok-putina.org/ https://zampolit.com.
La mise sous sanction d’une personne résulte ainsi d’éléments factuels non vérifiés de manière indépendante, souvent présentés avec partialité par des sites idéologiquement orientés.
Le respect des droits fondamentaux de l’individu concerné n’intervient donc pas en amont mais strictement et exclusivement en aval par la saisine du Tribunal de l’Union européenne, soit, après que celui-ci ait été privé, outre de son droit à la défense, de ses avoirs européens et de sa liberté de se mouvoir.
À ceci, les représentants de l’Union européenne argueront, d’une part, que les sanctions sont de simples mesures conservatoires, réévaluées tous les six mois et, d’autre part, qu’il est possible de demander leur annulation devant le Tribunal de l’Union européenne pour divers motifs, notamment l’erreur d’appréciation du Conseil. L’idée sous-jacente est que les sanctions ne seraient pas de nature pénale – ce qui justifierait que l’on se passe d’instruction sérieuse, que l’on outrepasse les droits de la défense et que l’intervention d’un juge ne soit que postérieure.
De tels arguments se heurtent hélas à la réalité de l’application et de la mise en œuvre des sanctions, qui ne sont pas toujours levées, même après une annulation judiciaire.
Les sanctions en pratique
La mise en œuvre des sanctions soulève de nombreuses problématiques pratiques.
Sans chercher à être exhaustif, notons dans un premier temps que les sanctions individuelles peuvent étonnamment être imposées sans qu’il soit nécessaire que les personnes visées aient un lien quelconque avec la guerre en Ukraine.
Plus encore, et a contrario du droit pénal, les sanctions peuvent s’étendre aux membres de la famille tels que les conjoints et les enfants sans qu’il soit nécessaire d’établir autre chose que le fait qu’un membre de la famille tire avantage de la personne désignée. Le Tribunal de l’Union Européenne retient dans un arrêt de juin 2024 qu’ « en l’espèce, il convient de constater que le Conseil a décidé de réinscrire le nom de la requérante sur les listes en cause sur le fondement d’un seul motif, à savoir son lien avec (X), qui en l’occurrence est son mari».
La réévaluation des situations individuelles des personnes sanctionnées, intervenant tous les six mois est censée permettre aux personnes sanctionnées de modifier le comportement qui leur est reproché de sorte à ce que les mesures prises à leur encontre puissent être levées lorsque ledit comportement a cessé.
Toutefois, lorsque les motifs retenus par le Conseil ne font pas référence à une situation continue comme être un actionnaire ou un dirigeant d’une société donnée mais plutôt à une action passée, comme avoir voté une loi ou avoir réalisé une opération, on voit mal comment la réévaluation semestrielle pourrait conduire à faire cesser les sanctions. Que pouvons-nous changer du passé ?
C’est ici que la pratique du Conseil commence à contredire les textes européens conférant potentiellement un caractère perpétuel aux sanctions.
Plus étonnant encore, force est de constater que les justiciables qui ont réussi à faire annuler les sanctions à leur encontre par le Tribunal de l’Union Européenne sont presque systématiquement resanctionnés, soit (i) sur la base d’une motivation modifiée, soit (ii) sur la base d’un changement du critère applicable, soit (iii) avec la même motivation mais en ayant préalablement modifié les termes du critère utilisé.
En matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) dont les sanctions relèvent, le Conseil agit en tant qu’organe exécutif ET législateur de l’Union. Il peut ainsi modifier les termes des règlements au fur et à mesure que sa mise en œuvre est invalidée par le Tribunal. Cet état de fait se heurte au concept clef de Tocqueville : la séparation des pouvoirs.
Cette « particularité institutionnelle européenne » restreint drastiquement l’efficacité des recours juridictionnels et contredit selon nous l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En d’autres termes, tant que la volonté politique demeure, les actions judiciaires intentées devant les juridictions européennes sont d’effet particulièrement limité.
Cette réalité découle également de la mécanique juridique des sanctions. Même après une victoire judiciaire, aussi surprenant que cela soit, les sanctions ne cessent de produire leurs effets que si le Conseil y consent et adopte une décision ad hoc retirant la personne de la liste.
On a ainsi pu voir le cas d’une personne qui, prenant en compte les motifs retenus à son encontre, avait démissionné de ses fonctions. Après avoir obtenu l’annulation de tous les renouvellements, elle est néanmoins demeurée sous sanctions, les autorités arguant que la décision initiale à son encontre et qui n’avait pas été annulée (elle n’avait alors pas encore démissionné) n’est pas limitée dans le temps…
D’aucun désignerait cette situation comme un cas patent de déni de justice aux effets contre-productifs : quel intérêt peut-il avoir pour une personne sanctionnée à changer de comportement si les sanctions demeurent ?
La nature supposément temporaire et conservatoire des privations de libertés fondamentales se trouve ainsi fermement démentie par les faits.
Dès lors, comment justifier que les personnes concernées soient privées des droits d’une défense pénale, notamment ceux résultant d’une instruction à charge et à décharge, de l’accès au dossier et de l’intervention d’un juge en amont desdites privations ?
Ainsi, bien que ces sanctions soient perçues par une partie de l’opinion publique européenne comme légitimes car elles visent in fine le gouvernement de la Fédération de Russie et qu’elles touchent de riches Russes à l’éthique d’affaires parfois contestable, elles soulèvent des questions importantes liées au respect des principes juridiques fondamentaux des pays européens.
Accepter ces atteintes aux libertés fondamentales, en l’absence de garanties procédurales et de voies de recours effectives, revient à accepter de violer les principes juridiques historiques des États membres. Si ces méthodes semblent acceptables dans le cadre de la confrontation avec la Russie, il n’en reste pas moins qu’il y a là un déni de droit. Accepter ces graves entorses aux libertés fondamentales au prétexte que les personnes visées sont russes, c’est remettre en cause les valeurs même que nous cherchons à défendre. C’est ouvrir une brèche dans l’État de droit.
Comment alors être sûr que de tels mécanismes ne viseront pas un jour des citoyens européens ?
L’article Vaincre la Russie à tout prix, même celui de l’État de droit ? est apparu en premier sur Causeur.



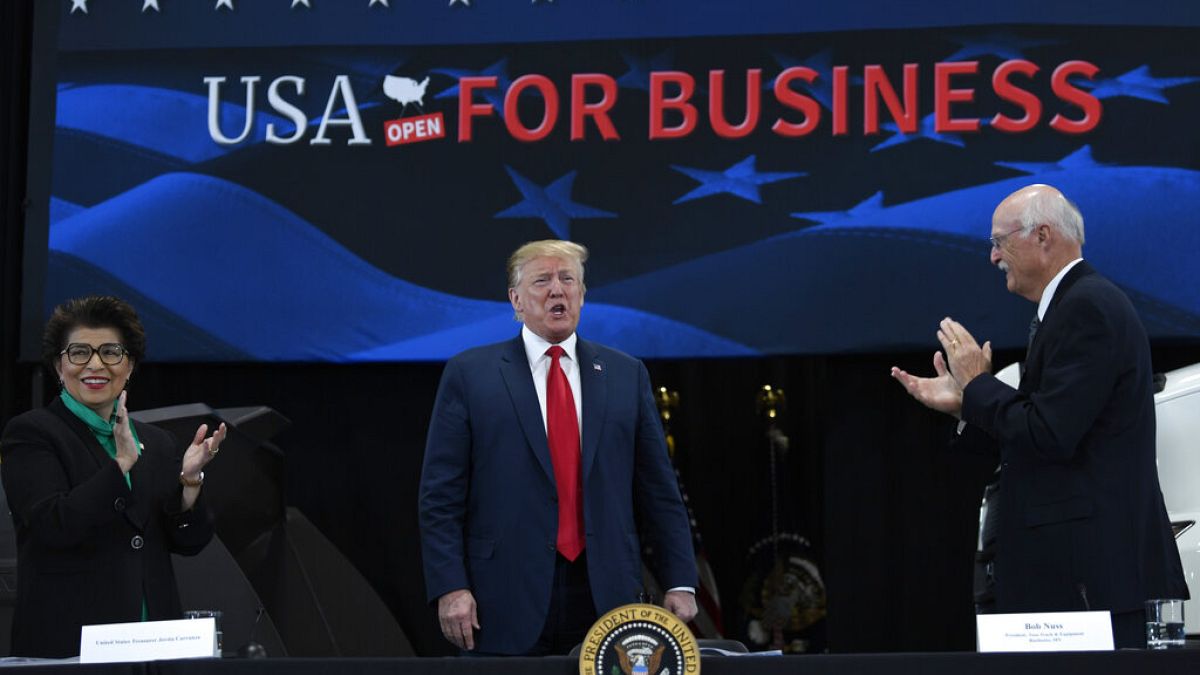




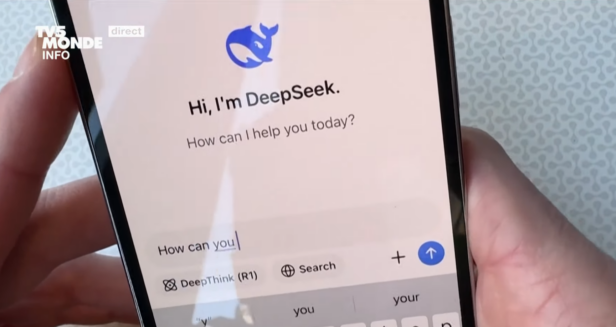


![[EXPO] Le musée Rodin tendance woke : sus à la grossophobie et au mâle blanc !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/vignette-rodin-balzac-616x347.jpeg?#)