Revisiter les origines de notre République parlementaire pour sortir de l’impasse politique
Il y a 150 ans, les lois constitutionnelles de la IIIᵉ République permettaient une première expérience durable de démocratie parlementaire en France. Cet épisode est riche d’enseignement alors que notre Vᵉ République est en crise.


Il y a 150 ans, le 30 janvier 1875, l’adoption de l’amendement Wallon ouvrait la voie au vote des lois constitutionnelles de la IIIe République, première expérience durable en France de démocratie parlementaire. Ce modèle pourrait-il nous aider à sortir de l’impasse politique et institutionnelle actuelle ?
En mai 1870, le Second Empire semble ressourcé par le plébiscite constitutionnel qui libéralise le régime et rend des droits au Parlement. Pourtant, la guerre déclarée par Napoléon III à la Prusse le 19 juillet 1870 tourne au désastre pour l’armée française. La défaite de Sedan et la capitulation de l’empereur entraînent le 4 septembre 1870 la chute du régime et la proclamation de la IIIe République.
Il faut cinq années à la République pour se doter enfin d’institutions en raison de la composition de la « Chambre introuvable » élue en février 1871. Souhaitant avant tout la fin de la guerre, les Français accordent massivement leurs voix aux monarchistes, majoritaires à l’Assemblée nationale (400 sur 675 élus) mais profondément divisés. La restauration de la monarchie semble alors proche. L’intransigeance du prétendant au trône, le comte de Chambord, qui refuse par exemple le drapeau tricolore, rend impossible le projet d’un retour à la monarchie. Cela conduit bon nombre d’orléanistes, sous l’impulsion d’Adolphe Thiers, à se résoudre à la République, pourvu qu’elle soit parlementaire et conservatrice. L’acceptation de la République constituant la ligne de partage des eaux entre la droite et la gauche, c’est donc au centre de l’Assemblée nationale que tout se joue.

L’amendement Wallon et les lois constitutionnelles
En 1873, une loi confie à une commission de trente membres l’élaboration des lois constitutionnelles. Professeur de législation comparée, le député Laboulaye propose le 28 janvier un amendement introduisant le terme de République, absent du texte initial : « Le Gouvernement de la République se compose de deux chambres et d’un président. » L’amendement Laboulaye est repoussé, mais de peu (359 voix contre 336).
L’historien catholique Henri Wallon, député du Nord, membre d’un petit groupe « trait d’union » entre le centre gauche et le centre droit, propose à son tour un amendement ainsi rédigé :
« Le président de la République est élu à la pluralité des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible. »
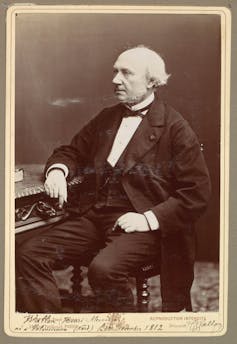
Des négociations se déroulent entre les libéraux et les républicains de Gambetta et de Ferry. Lors de la séance du 30 janvier 1875, Wallon se défend de proclamer la République, il ne fait que prendre « ce qui est » pour sortir du provisoire et stabiliser le mode de gouvernement. L’amendement Wallon est adopté à la majorité absolue, par 353 voix contre 352.
Une majorité plus large se constitue pour voter les trois lois constitutionnelles : 34 articles au total, sans déclaration de droits ni préambule. Cet ensemble établit un régime parlementaire équilibré, mêlant les traditions orléaniste et républicaine : deux chambres votant les lois et le budget et élisant ensemble, pour un mandat renouvelable de sept ans, le président de la République. Ce chef de l’État dispose de pouvoirs étendus : il dispose de pouvoirs très larges : nomination du chef du gouvernement, promulgation des lois, droit de dissoudre la Chambre des députés sur avis conforme du Sénat.
La dernière étape de la conquête de la République par les républicains passe par une épreuve de force, la crise initiée en 1877 par la dissolution de la Chambre par le président de la République, le monarchiste Mac-Mahon, et la victoire de la majorité parlementaire de Gambetta. Avec la démission de Mac-Mahon le 30 janvier 1879 et l’élection le jour même pour lui succéder du républicain Jules Grévy, les républicains contrôlent désormais tous les leviers du pouvoir et peuvent mettre en œuvre leur programme : laïcisation de la société, réforme de l’école, extension des libertés (presse, réunion, syndicats), à l’origine du modèle républicain français.
La IIIᵉ République, repoussoir ou source d’inspiration ?
Au miroir déformant de l’effondrement national et démocratique de « l’étrange défaite » de juin 1940, la IIIe République a subi une « légende noire » alimentée par Vichy, mais aussi par la Résistance, et reprise par la République gaullienne, groupée dans un rejet commun avec le « régime des partis » de la IVe République.
Ce discrédit global fait fi des fortes variations entre 1870 et 1940 et néglige les apports considérables d’un modèle parlementaire accompli porteur de nos grandes lois garantissant les libertés individuelles et publiques à un niveau inédit : presse, association, réunion, laïcité, décentralisation municipale, instruction publique, avancées sociales et culturelles du Front populaire. Réduire la plus durable des Républiques parlementaires à une combinaison d’instabilité gouvernementale permanente et de blocage politique sur les réformes est en grande partie injuste et inexact.
Avant 1914, de profondes transformations sont mises en œuvre, en dépit de vagues violentes de contestations populistes (scandale de Panama et des décorations, boulangisme, antidreyfusisme), et avec un personnel ministériel de grande qualité et stable, formé par l’école du barreau et les rédactions des journaux.
La dégradation du système durant l’entre-deux-guerres et son effondrement ont alimenté le mythe d’une litanie de gouvernements faibles, éphémères et impuissants. Certes, le poids prépondérant d’un Sénat conservateur bloque des réformes majeures (droit de vote des femmes, création de l’ENA par Jean Zay), et l’absence de contrat de législature entre les partis d’une alliance électorale débouche trop souvent sur des retournements d’alliance à mi-mandat, qui flouent les électeurs sans les consulter, en 1926, 1934 et 1938.
Par ailleurs, l’impuissance du président de la République depuis la crise fondatrice de 1877 (la « Constitution Grévy »), déséquilibre le parlementarisme. Ce constat partagé nourrit pendant l’occupation les propositions de réforme de Léon Blum, de Jean Zay puis de Pierre Mendès France en faveur d’un contrat de gouvernement pour toute la durée d’une législature, offrant un choix clair aux citoyens entre les programmes conservateur et progressiste.
Dans la France de 2025 – par bien des aspects très différente – la nécessité de rééquilibrer les institutions de la République pour mieux écouter les citoyens n’est-elle pas également urgente ? La crise de défiance envers la démocratie représentative pourrait inciter à revisiter notre pratique en sortant de l’obsession de l’échéance présidentielle ? Il s'agirait de redonner la parole aux parlementaires et, au-delà, aux 500 000 élus locaux, formidable vivier démocratique, ou encore de s’appuyer sur les conventions citoyennes sur le climat et la fin de vie. Autant de moyens pour revitaliser la Ve République ou préparer le passage à la VIe République.![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.








![[LE CROC D’IXÈNE] Le ministre des Familles lance « Démographie 2050 »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/bv77-de-mographie-2050-vgn-516x482.jpg?#)


![[POINT DE VUE] Terrible constat : notre aviation de chasse tiendrait 3 jours](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2021/05/rafale-616x379.png?#)


































![[#Fridaynews 357] L’actualité Réseaux Sociaux de la semaine](https://swello.com/fr/blog/wp-content/uploads/2024/11/fridaynews-357.png)




























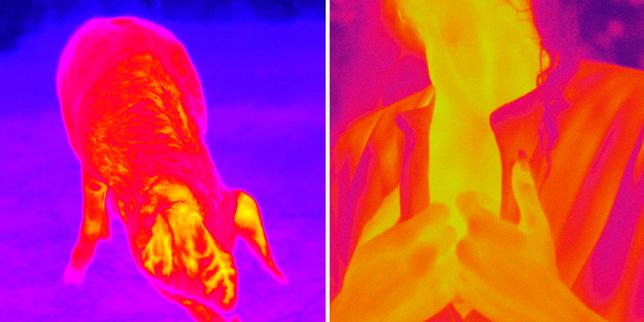

![Il n’y a jamais eu autant de cyberattaques qu’en 2024 : mais que font les entreprises ? [Sponso]](https://c0.lestechnophiles.com/www.numerama.com/wp-content/uploads/2024/09/fuite-de-donnees.jpg?resize=1600,900&key=5c92933b&watermark)