Inscrire le non-consentement dans la définition du viol : pourquoi la France tergiverse
Un texte de loi préconise d’intégrer le non-consentement dans la définition du viol. Quelle serait la bonne approche pour réformer le droit français ? Plusieurs pays d’Europe ont déjà franchi le pas.

S’appuyant sur un rapport rendu public le mardi 21 janvier, un texte de loi transpartisan préconise d’intégrer le non-consentement dans la définition du viol. Quelle serait la bonne approche pour réformer le droit français ? Plusieurs pays d’Europe ont déjà inscrit le consentement dans la loi et pourraient nous inspirer.
Selon le Code pénal, le viol est défini comme un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Pour prouver que la victime n’était pas consentante et donc pouvoir condamner l’agresseur, les juges doivent démontrer que l’auteur a commis l’acte sexuel en utilisant la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Par un curieux paradoxe, l’incrimination du viol est donc tournée vers le défaut de consentement de la victime mais occulte soigneusement de le nommer.
C’est à cette lacune que se propose de répondre la proposition de loi déposée le 21 janvier 2025. Elle énonce que le consentement suppose d'avoir été donné librement, qu'il est spécifique et qu'il peut être retiré à tout moment. Elle décrit des situations dans lesquelles il n'y a pas de consentement – violence, menace, surprise ou contrainte –, mais aussi en cas d'exploitation de la vulnérabilité de la victime.
Hostilité française aux réformes européennes
Jusqu'à présent, la France ne s’est pas mise en conformité à la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, signée en 2011 (et ratifiée par la France en 2014).
Cette Convention traite de la question du consentement dans le viol en ces termes : « Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ». Le GREVIO (Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique), organe de contrôle de l’application de la convention d’Istanbul, a rendu un rapport relatif à la France en 2019. Ce dernier pointe les lacunes de la législation française du fait de son refus d’intégration de la notion de libre consentement.
L’opposition française à l’intégration du consentement dans la loi pénale sur le viol s’est révélée lors de la proposition de directive, émise par la Commission européenne en mars 2022, relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Une dizaine d’États, dont la France, se sont opposés à ce texte et leur hostilité était dirigée contre l’article 5, qui prévoyait une définition du viol exigeant d’entendre « par acte non consenti, un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement, ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre ».
Dupont-Moretti justifie l’opposition au consentement
Auditionné le 1er février 2024 par la délégation aux droits des femmes au Sénat, le ministre de la Justice alors en poste, Éric Dupont-Moretti, tentait de justifier cette hostilité française. Il rappelait que la France s’opposait à ce texte car l’article 83 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne limite la compétence européenne en matière de création d’incriminations à une liste d’infractions (notamment l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants) dont ne fait pas partie le viol.In fine, les États membres ne sont pas parvenus à un accord et la directive a été adoptée le 14 mai 2024 sans son article 5.
Étonnamment, un mois après l’audition du ministre de la justice, le président de la République, à l’occasion de la journée du 8 mars, déclarait être favorable à l’intégration dans la loi pénale du consentement en matière de viol. Les arguments évoqués auparavant ne semblaient plus aussi prégnants sans que l’on puisse en comprendre réellement la raison, sauf à concevoir que la pression sociétale ait pesé sur les choix politiques. La volonté politique de changer la loi sur le viol a été par la suite confirmée par l’ancien ministre de la justice Didier Migaud à l’automne dernier, alors que le procès des viols de Mazan s’ouvrait. Le choc suscité par ce procès au sein de la société n’est certainement pas étranger à la mutation du gouvernement sur cette question.
Une réforme française inévitable ?
La France pourra difficilement faire l’économie d’une réforme car, si elle a réussi à échapper aux obligations de l’Union européenne en obtenant le retrait de l’article 5 de la directive, elle ne peut occulter ses obligations relatives à la jurisprudence de la Cour européenne. En effet, depuis l’arrêt de la Cour européenne M.C. c. Bulgarie du 4 décembre 2003, les juges de Strasbourg ont imposé aux États une obligation positive de promulguer une législation pénale permettant de punir effectivement le viol par une appréciation de la notion de consentement qui ne soit pas fondée uniquement sur l’exigence d’une violence ou d’une opposition physique de la victime.
Cette décision a été rendue il y a plus de 20 ans et, depuis, la Cour a toujours maintenu cette position comme encore récemment lors de l’arrêt du 12 décembre 2024, affaire Y. c. République tchèque. Le couperet se rapproche cette fois-ci de la France puisque sept requêtes sont actuellement pendantes devant la CEDH concernant le traitement judiciaire français du viol. Sans faire de droit fiction, il est probable que la France soit condamnée en 2025 au regard de la jurisprudence européenne.
Sans attendre cette probable condamnation, La France s'engagera-t-elle sur la voie d’une réforme à la suite de la proposition de loi déposée le mardi 21 janvier 2025 ? Quel texte pourrait-être retenu ?
Exemples européens en matière de consentement
Nombreux sont les pays européens à avoir changé leur législation récemment: la Suède, l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Croatie, le Danemark, etc. Ainsi, la loi belge relative au droit pénal sexuel de mars 2022 a modifié l’infraction de viol et prévoit désormais une définition détaillée du consentement. Cette définition a d’ailleurs été une base de travail importante pour la proposition de loi française déposée le 21 janvier 2025, notamment en raison de la proximité des procédures pénales belges et françaises.
De même, l’expérience de la Suède, qui a changé sa législation en 2018, est intéressante. Une évaluation de l’impact de la définition suédoise du viol a été réalisée par le Conseil national suédois pour la prévention de la délinquance. Cette évaluation a permis de mettre en exergue un certain nombre d’avantages concrets offerts par la réforme.
« Premièrement, l’évaluation a montré que le nombre de signalements, de poursuites et de condamnations avait augmenté après la modification de la loi et que, plus précisément, le taux de condamnation avait augmenté́ de 75 %. »
L’évaluation suédoise souligne que la réforme
« permet de se prémunir contre les mythes profondément ancrés concernant le viol et la violence sexuelle et […], depuis l’adoption des modifications à la législation suédoise, la population est davantage sensibilisée à l’importance que revêt le consentement dans les relations sexuelles ».
Au regard de ces exemples européens, il semble indispensable que la France se dote à son tour d’outils efficients de lutte contre le viol.![]()
DARSONVILLE Audrey a reçu des financements de Direction administration pénitentiaire pour une recherche collective








![[ÉDITO] À Toulouse, Mélenchon valide et soutient le Grand Remplacement !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/melenchon-616x297.png?#)

![[CHRONIQUE] « Chacun doit prendre part à l’effort » : vraiment ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2020/02/800px-centre_des_finances_publiques_-_impots-616x462.jpg?#)
![[MEDIAS] Jean-Michel Aphatie sur l’Algérie : la haine viscérale de la France](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/capture-decran-773-616x347.png?#)







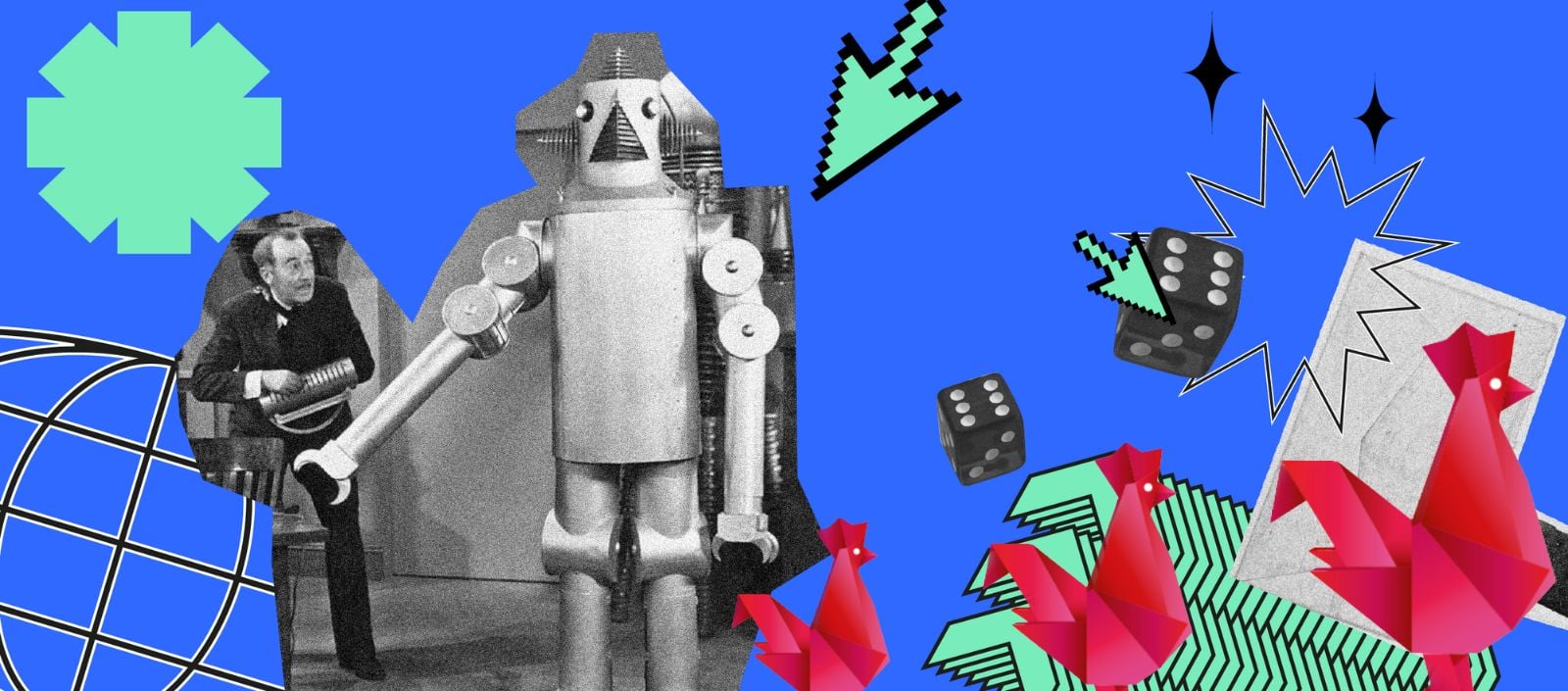














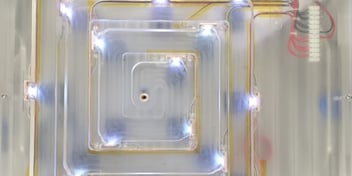













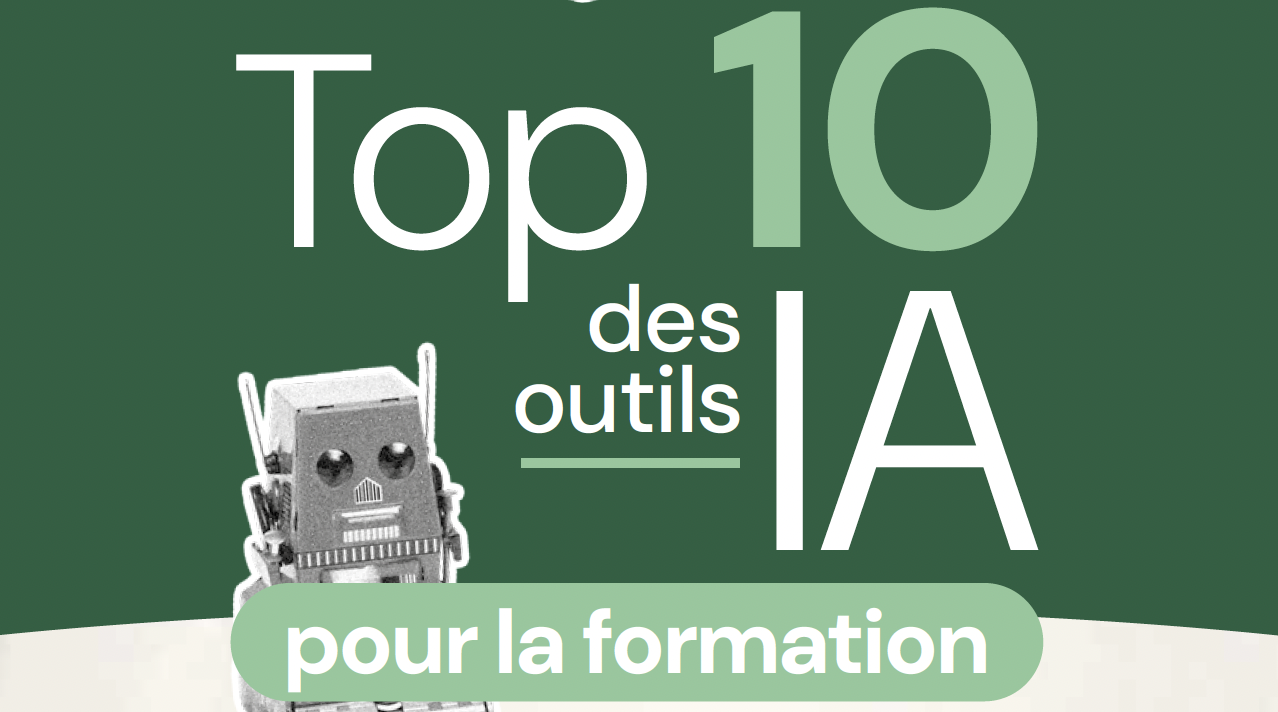
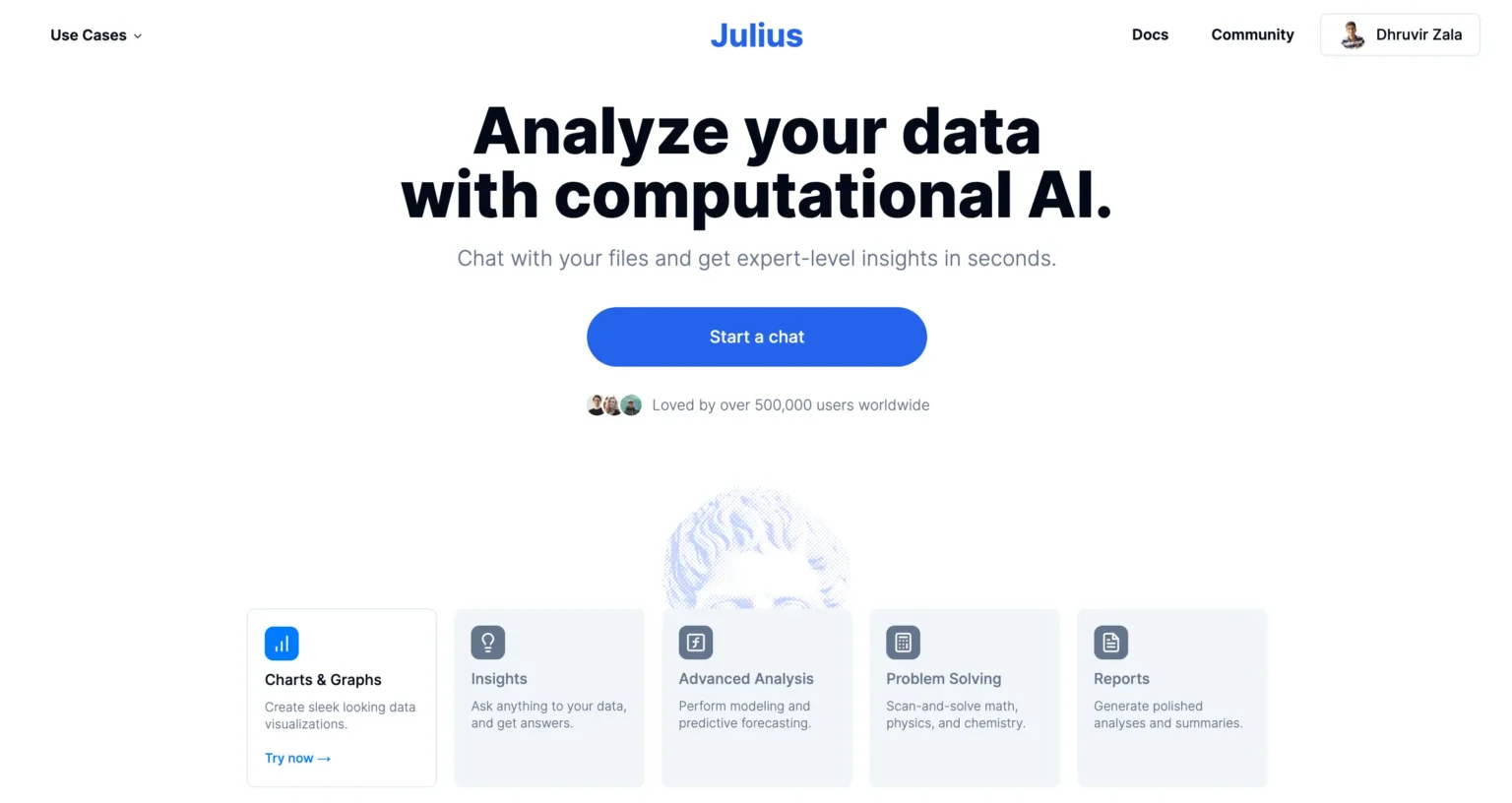
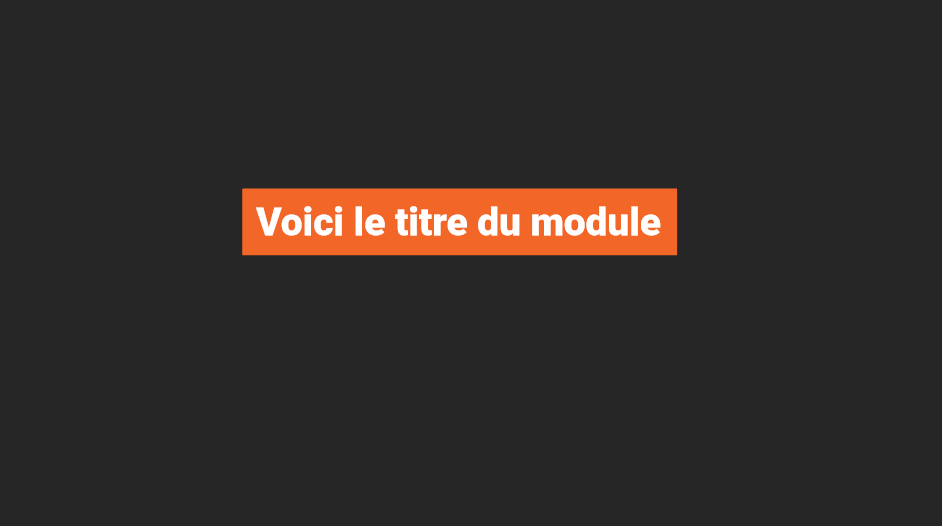




![« Sans stockage et gestion de l’énergie, pas d’avenir » [Nicolas Rochon, RGreen Invest]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image.png)


![Une tendance aux grands écarts dans l’irradiation solaire [Solargis]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image-1.png)
















