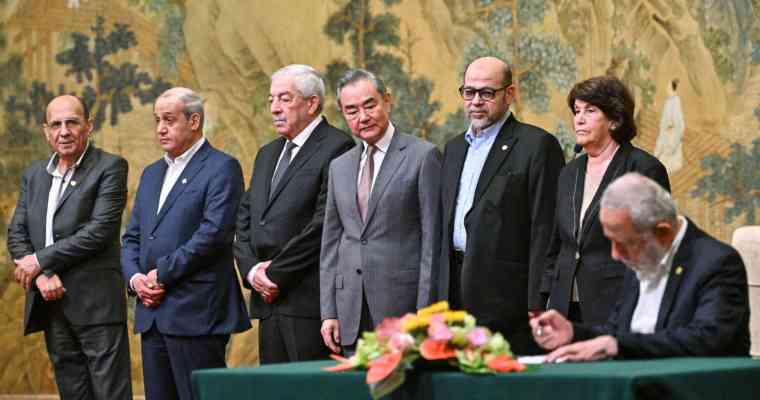Ce que j’ai vu à Washington
Le carnet de voyage du Franco-américain Nicolas Conquer, "Republicans Overseas", à l'investiture de Donald Trump... L’article Ce que j’ai vu à Washington est apparu en premier sur Causeur.

Jour 1 : Washington dort encore…
Vendredi soir 20h, 2h du matin heure française. Paris dort, l’Amérique est prête au grand réveil. Nous sommes J – 3 avant l’investiture de Donald Trump. En France, les médias s’emballent : pour certains, l’événement est un triomphe, la confirmation d’un retour au pouvoir éclatant ; pour d’autres, c’est un basculement inquiétant, une menace, la chronique d’un désastre annoncé. On repense à 2017, à ces images de vitrines brisées, de protestataires enragés, de rues en feu sous le regard médusé du monde. Mais ici, à Washington, sous ce soleil froid d’hiver, je n’ai jamais vu une ville aussi calme. Pas de cortèges furieux, pas de sirènes hurlantes, pas d’affrontements en prévision. Rien qu’un silence pesant, presque irréel. Il faut dire que l’équipe locale joue les play-offs du championnat de football américain, une première depuis 1999. Et ce soir, à Washington, c’est peut-être ça, la vraie nouvelle. Les commanders, anciennement redskins, qui ont dû être rebaptisés pour des raisons d’appropriation culturelle, les « peaux rouges » ayant chacun sait la peau rouge et non blanche comme certains joueurs de football américain. L’équipe de foot n’a en tout cas pas été cancellée des pubs et restaurants américains où le match tourne en permanence. Le sport est un rituel américain qui sert souvent de prétexte pour faire un barbecue chez soi entre amis.
L’actualité sportive ne suffit pas seule à expliquer cette sérénité à Washington… Rappelons-nous de la situation politique américaine en 2017 où Donald Trump entrait à la Maison Blanche au terme d’une campagne improvisée, virale, anarchique et gagnée par surprise sur le fil. Côté républicain, les élus se faisaient rares pour défendre leur candidat et la plupart ne croyaient pas qu’une victoire de Donald Trump soit possible. Le parti républicain était par ailleurs rempli de RINO (Republican in name only) ou d’élus « Never Trump » : tous ceux qui en 2016 avaient refusé par principe de soutenir le nominé de leur parti, même du bout des lèvres. Paul Ryan, alors président de la Chambre des représentants, avait déclaré devant ses troupes un mois avant l’élection en octobre 2016 qu’il ne dépenserait plus un dollar pour faire élire Donald Trump et se concentrerait sur les élections au Congrès. Républicain comme Trump, il a pourtant entravé certains de ses projets une fois élu, comme la construction du Mur. Trump devait composer avec ce parti à peine acquis et aussi éviter tous les bâtons dans les roues de ses adversaires et de l’Etat profond. Les rumeurs sur l’ingérence russe débutent dès les premiers jours de sa présidence ainsi que l’enquête fédérale. Beaucoup pariaient sur un mandat écourté par un impeachment.
Aujourd’hui la situation a décidemment bien changé. Les démocrates n’ont pas fait de chichi pour concéder l’élection. Kamala Harris s’est piteusement aplatie. La transition politique a été paisible, sans interférences ou rumeurs. Surtout sa légitimité n’est pas discutée : remportant le vote populaire contrairement à 2016, il bénéficie du soutien des deux chambres du Congrès où le parti républicain y est majoritaire. Mais surtout un parti républicain à sa botte…. Alors qu’en 2016, quelques grognards trumpistes comme Roger Stone et Rudy Giuliani relayaient la bonne parole dans les médias, les élus MAGA sont aujourd’hui nombreux à porter la parole présidentielle au Congrès. Le speaker républicain Mike Johnson doit son perchoir au soutien que Trump lui a apporté. Pas de rumeur d’impeachment, pas de contestation de sa légitimité… Rien n’est venu arrêter ou gâcher le plaisir de ces fêtes d’inauguration.
Jour 2 : petite cure de roman national
Je voyage dans l’espace, mais aussi dans le temps. Un détour de vingt minutes depuis Washington pour aller voir… Washington. Pas seulement la ville, mais l’homme, l’ancien général de la guerre d’indépendance, le premier président des États-Unis, le mythe fondateur en chair et en os transformé en icône. On l’appelle le Père fondateur, comme pour souligner une primauté qui dépasse l’individu, une figure si massivement enchâssée dans la narration nationale qu’elle semble avoir toujours été là. Sa demeure, Mount Vernon, est un temple à 30 dollars l’entrée. Le prix d’un ticket pour l’histoire et d’une immersion savamment orchestrée dans l’Amérique des origines. La vue est intacte, dégagée, identique à celle que devait avoir le père fondateur au XVIIIe : pas un pont, pas une route, pas une usine de retraitement des eaux, rien qui trahisse l’irréversible avancée du temps. Un décor reconstitué, conçu pour transmettre une illusion : celle d’une Amérique pionnière, à l’état brut, qui aurait pu rester figée à l’état de pureté pré-industrielle. Et bien sûr, l’ombre portée de la France, l’alliée providentielle. Trois portraits de Louis XVI, un hommage discret à La Fayette, autant de rappels que l’indépendance américaine n’était pas seulement une affaire intérieure, mais un ballet transatlantique de calculs et d’idéaux. Deux cent cinquante ans après, l’anniversaire approche. Washington est la ville-musée de la Religion civile américaine. Sur la Pennsylvania Avenue, ses temples institutionnels aux colonnades néoclassiques en béton s’alignent comme des autels, chacun consacré à un pan du mythe national. Pour un Français, une certaine lassitude guette. Trop de monumentalité, trop de symboles martelés, une grandiloquence où le recueillement peine à exister. On se prend à rêver à une petite église romane, à la patine discrète des siècles, à une mémoire qui s’offre sans mise en scène.

Mise en scène de l’histoire, odeur feutrée de nostalgie et monumentalité imposante… le storytelling américain éclaire aussi un peu le phénomène Trump. L’Amérique comme les cités antiques aime se raconter sa propre histoire : sur les monuments, dans les musées, dans les séries, les films, par sa production culturelle. L’Amérique cultive bien plus que nous le culte de l’homme fort. Donald Trump excelle dans cette partition. Les « Fight, fight ! » assenés le poing levé dans ses discours, les démarches sur scène un peu viriles et boursouflées, peut-être grotesques pour un public européen, sont autant de rappel à l’origine violente et combattante de l’Amérique, nation née dans l’apprêté du conflit entre l’homme et la nature sauvage. C’est aussi la figure du ressuscité cher à Saint Paul et aux protestants : il survit aux balles, aux enquêtes judiciaires, aux vents contraires de la vie politique comme il a survécu alors qu’il était homme d’affaires aux faillites ! En 2020, malade du Covid, il est rapidement soigné et alors que son hélicoptère se pose sur la pelouse de la Maison Blanche, il donne l’impression de revenir des enfers, ressuscité après avoir dépouillé le vieil homme qui était en lui… Un showman hors pair du roman national américain. On attend donc avec impatience le spectacle de lundi.
Jour 3 : veillée d’armes
La veille, il y a le grand rassemblement des partisans de Trump à l’Aréna. Le Capital One est gorgé de casquettes rouges. L’atmosphère s’enflamme avant même l’arrivée de Trump. Le froid polaire contraint l’évènement à se tenir dans une arène mais cela n’altère pas l’enthousiasme de la foule. 25 000 personnes vibrent aux discours des orateurs parmi lesquels Elon Musk dont les exploits font grand bruit. On retrouve tout le folklore MAGA avec les concerts de rock, les chants patriotiques, le fameux Kid Rock, le chauffeur de salle régulier des meetings de Trump. L’arrivée du président élu comme son discours sont bien sûr applaudis par une salle en fusion. Trump en fin de meeting fait remarquer à la foule qu’il y a cinq micros sur scène, réservant une surprise… C’est l’étonnant retour des Village People sur scène. Cependant, le flic afro-africain est le seul interprète de l’époque. Trump n’a jamais cessé de faire campagne. Pendant sa première présidence, il ne se privait pas de tenir des meetings aux quatre coins de l’Amérique à un rythme régulier, comme s’il était encore en campagne. Trump bat le fer quand il est chaud et se fait applaudir par une base militante en pleine communion. Trump a le goût de la scène. Il a aussi un certain sens politique. Dans le panier de crabes politique de Washington, ses fans sont en fait ses seuls véritables alliés. Les maintenir mobilisés par ces rassemblements, c’est garder une pression constante sur tout le personnel politique et les élus du Congrès, lesquels, même lorsqu’ils sont républicains, peuvent être tentés de freiner ou de modérer certains projets.
Ces parades sont toujours l’occasion d’expérimenter le gigantisme américain : des petits déjeuners gargantuesques de l’Hotel Hay Adams, un lieu qui appartenait au secrétaire de Lincoln, à quelques pas de la Maison-Blanche, aux soirées exubérantes, je donne quelques interviews pour CNews ou Frontières pour partager ainsi l’ambiance unique de ce moment historique et des bals inauguraux où j’ai l’honneur de figurer. Il faut savoir paraître. Noeud papillon et veston. Comme le journaliste routier Guy de la Rigaudie, je ne voyage qu’avec le minimum vital : mon sac de couchage et mon smoking.
Jour 4 : un lundi pour l’histoire
Ce lundi est un jour l’histoire. En ce matin d’investiture, Trump assiste à une messe privée à l’église Saint-Joseph. J’ai une position privilégiée. L’appartement où je réside donne sur le lieu : je peux assister à l’arrivée du président sous haute sécurité. Un instant rare et solennel. Pierre-Jean Chalençon fait aussi partie du voyage. Le propriétaire d’une grande collection Napoléon rappelle qu’il possède aussi une casquette originale signée par Donald Trump et remis par Jason Miller. Acmé de liturgie politique américaine au Capitole. Ce matin, Washington n’est plus seulement la capitale d’une nation, elle est le sanctuaire d’un culte. Le ciel est bas, l’air presque immobile, comme si le destin lui-même retenait son souffle. L’estrade est dressée, la Bible attend. Les paroles fatidiques de la prestation de serment seront prononcées dans quelques instants, des mots devenus rituels pour ces grandes messes civiques. Jamais l’Amérique n’a semblé aussi prête à se recueillir dans l’adoration de sa propre République.


Dans l’arène, l’effervescence est palpable. Le spectacle de la démocratie en action fascine, envoûte, captive. On entrevoit des visages graves, certains en transe, d’autres en contemplation. Trump pour sa prestation sait que ses mots resteront, que ce moment trouvera sa place parmi les grandes archives de l’Histoire : JFK et son rappel au devoir civique « ne vous demandez ce que votre pays peut faire pour vous… », Roosevelt et sa mise en garde contre la peur. Aussi, le 47e président ne déçoit pas. Son appel à « un nouvel âge américain » convoque tous les mythes fondateurs de la nation qu’il préside : élu du peuple érigé en héros, réformateur de l’Etat, régénérateur de la nation qui s’attend à connaître un nouvel âge d’or. Trump n’est pas de ceux qui recherchent le consensus. Il ne fera pas un discours solennel et consensuel à la Obama et n’hésite pas à piquer par une réplique mordante et une attaque voilée Biden et Harris qui se tiennent à quelques mètres de lui… Sous la rotonde du Capitole, la chanteuse country Carrie Underwood fait vibrer « America the Beautiful » a capella. Un petit couac technique aurait pu faire vaciller le beau moment, mais elle se rattrape, et le silence religieux de la foule, puis l’explosion d’applaudissements, transforment l’événement en épiphanie patriotique. L’Amérique écoute, et l’Amérique y croit.
J’attends trois heures dans la file d’attente aux côtés d’un juif ultra-orthodoxe, de sa femme et leur nouveau-né. On regarde ensemble la prestation de Musk, et son geste décrit comme un simulacre de salut nazi. Au moment où il tend son bras vers la foule pour lui offrir « tout son cœur », il n’y a pourtant aucune réaction dans la foule. Pas davantage chez mon interlocuteur qui aurait pu se sentir blessé. Un calme précaire toutefois : je connais le monde médiatique, je sais comment ce geste sera interprété. L’indignation ne tarde jamais. Le rythme de la journée alterne entre effusions et solennité. Point d’orgue émotionnel du spectacle : des familles des otages retenus à Gaza montent sur scène dans un calque soigneusement mis en scène qui rappelle l’investiture de Reagan en 1981 et la libération des otages de l’ambassade de Téhéran. La veille, Kid Rock bondissait sur scène dans un tumulte d’enthousiasme redneck. Aujourd’hui, la cadence est plus éparse et réfléchie, habitée par un poids historique. Une régie technique approximative n’arrive pas à briser l’ampleur du moment. La parade est sage, sans grandiloquence. Ceux qui aiment les processions militaires du 14-Juillet resteraient sur leur faim : l’Amérique ne montre pas ses muscles de cette façon. Ici, la puissance se suggère plus qu’elle ne s’affiche. Je capte cette ambiance et en fais part aux médias français. Les médias alternatifs s’emparent du moment. Interview pour Frontières, puis un échange avec « Tocsin », ces voix qui s’élèvent en marge des grands circuits d’information.
Jour 5 : un mardi après l’histoire
Mardi, la fête est passée. Petite pause après l’effervescence politique avec une session au stand de tir. Un moment privilégié pour exercer mes « god-given rights ». Je m’exerce avec Louis Sarkozy. La maîtrise des armes y est vue comme un exercice de discipline et de contrôle de soi, bien loin des clichés européens où l’on comprend mal notre attachement au second amendement de la Constitution. Le soir, j’honore une invitation pour une soirée cigare au très sélect University Club, fondé par le président Taft (un pourfendeur de l’omnipotence de l’Etat fédéral américain et une sorte de modèle d’élégance) et le général Pershing (aussi un modèle d’élégance) Ce lieu chargé d’histoire est un rendez-vous incontournable des élites washingtoniennes. Anecdote amusante : comme on jouxte la résidence de l’ambassadeur de Russie, on plaisante sur le fait que cet endroit doit être le plus écouté par le FBI et les services secrets russes. L’enquête sur l’ingérence russe, qui avait parasité le début du mandat de Trump, est bien loin… Ici, on débat, on lit, et l’atmosphère feutrée rappelle le Washington d’antan…

Jour 6 : L’Amérique éternelle
La dernière journée est placée sous le signe de la mémoire. Passage au cimetière militaire d’Arlington pour me recueillir sur les tombes des présidents et des soldats tombés pour la nation. Puis, un arrêt au Lincoln Memorial, où l’image saisissante d’un National Mall glacé contraste avec la ferveur politique des jours précédents.
Passage aux bureaux du Sénat dans le Russel Building, où se tiennent les auditions pour la formation du cabinet Trump. Washington bruisse déjà des luttes d’influence et des tractations en coulisses.

Trump inaugure son mandat d’une manière bien différente de celle de 2016, je l’ai déjà dit : le parti républicain est au garde-à-vous. L’Etat profond est sur la défensive… Dans les soirées de cette aventure Trump 2.0, il y a des trumpistes mais aussi des décideurs pas forcément politiques : des investisseurs dans l’IA et la cryptomonnaie… Tous savent que c’est ici que le pouvoir s’organise et que l’histoire s’écrit.
L’article Ce que j’ai vu à Washington est apparu en premier sur Causeur.








![[SANTÉ] Dramatique accident de car scolaire : tous drogués ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2019/03/car_man_drive_watch_hand-118477-616x411.jpg?#)

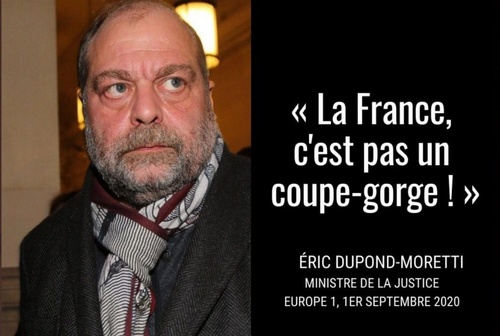

















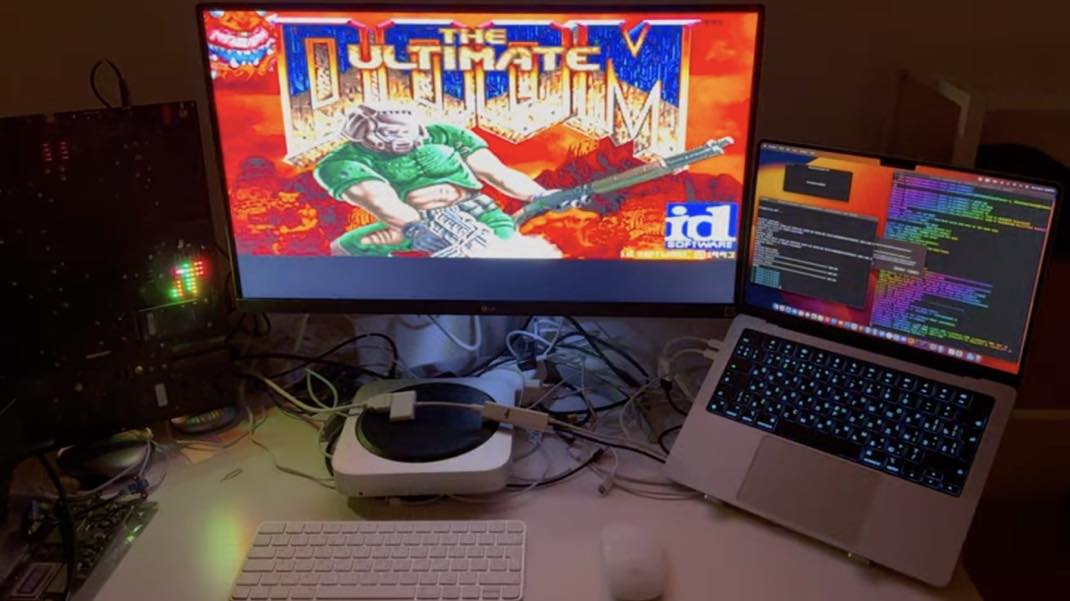


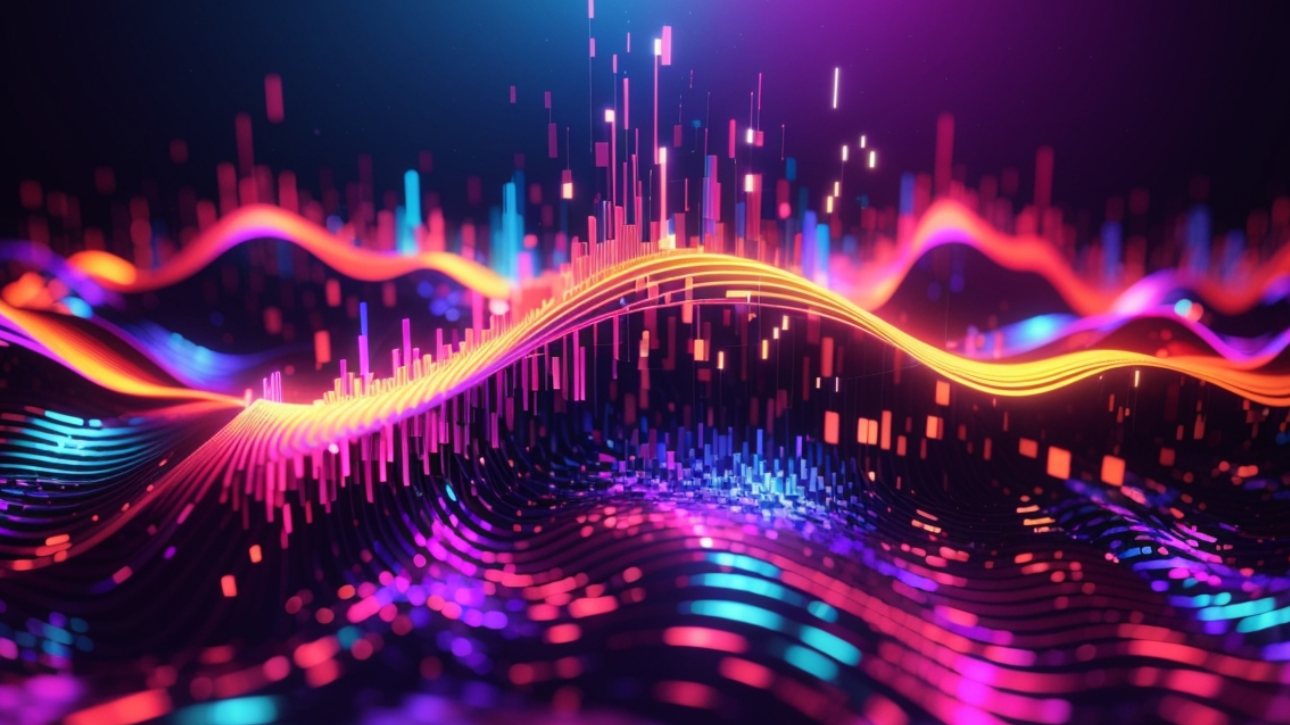





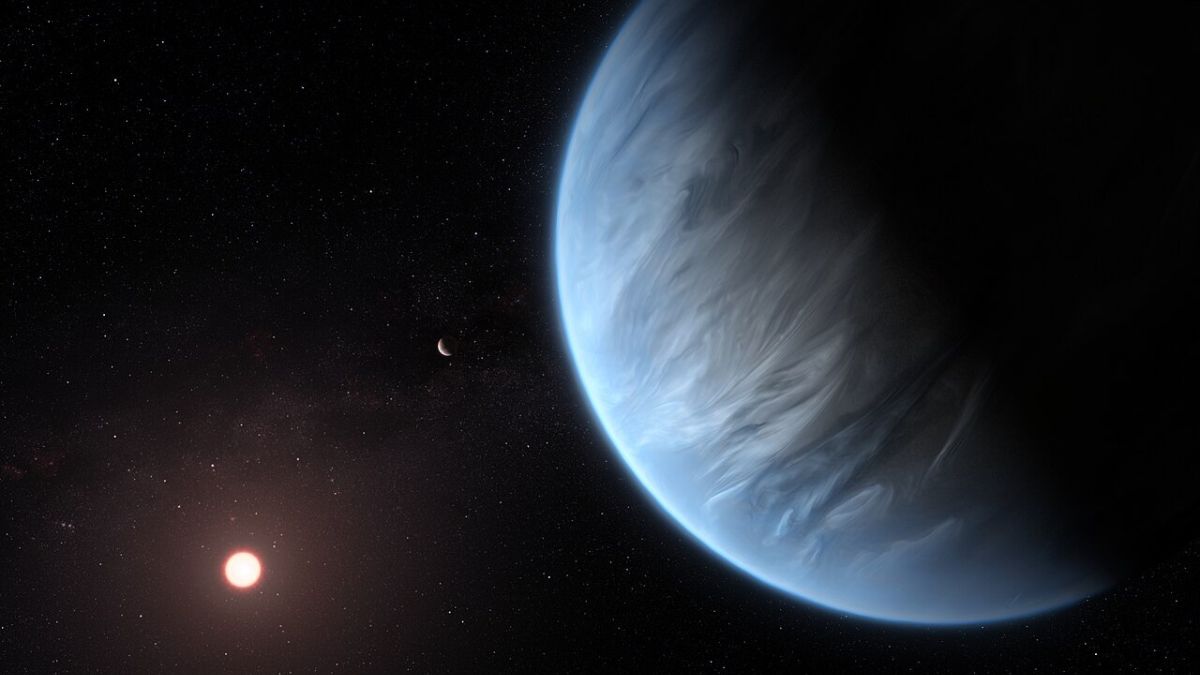











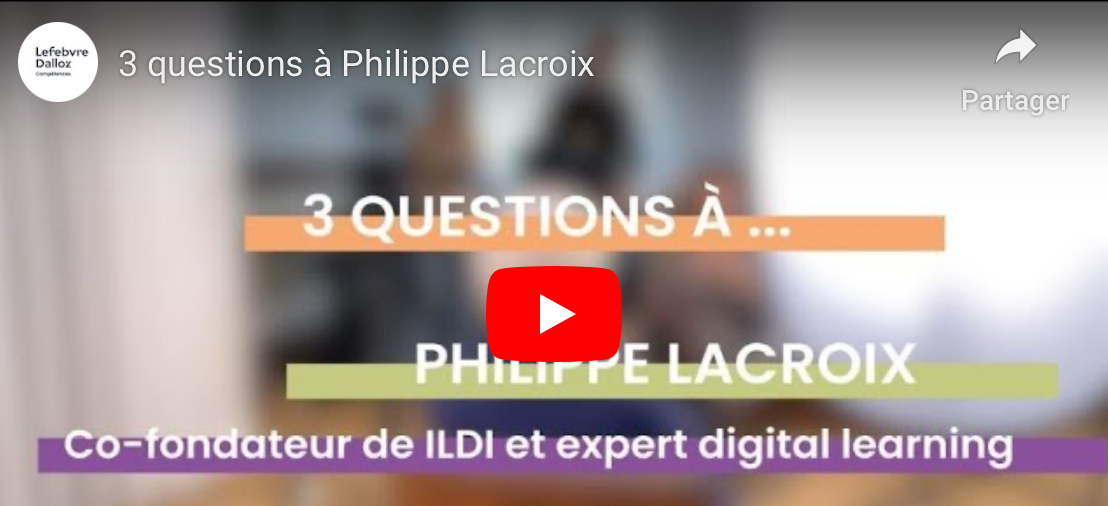

/image%2F0535633%2F20250202%2Fob_d1ef41_20241011-163729-2.jpg)