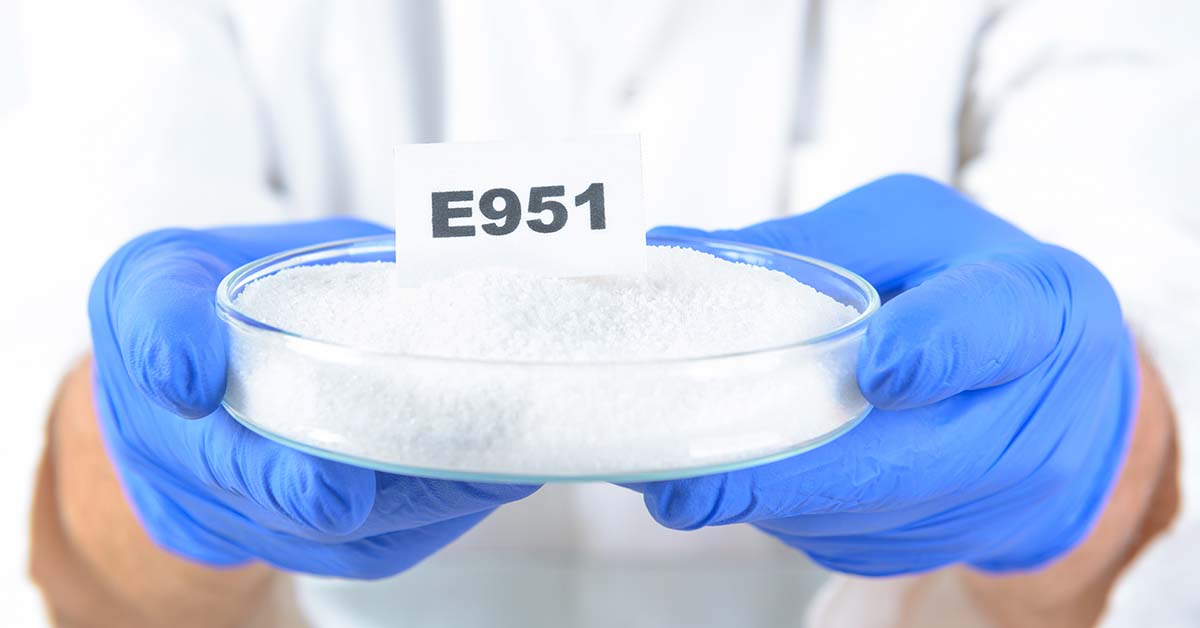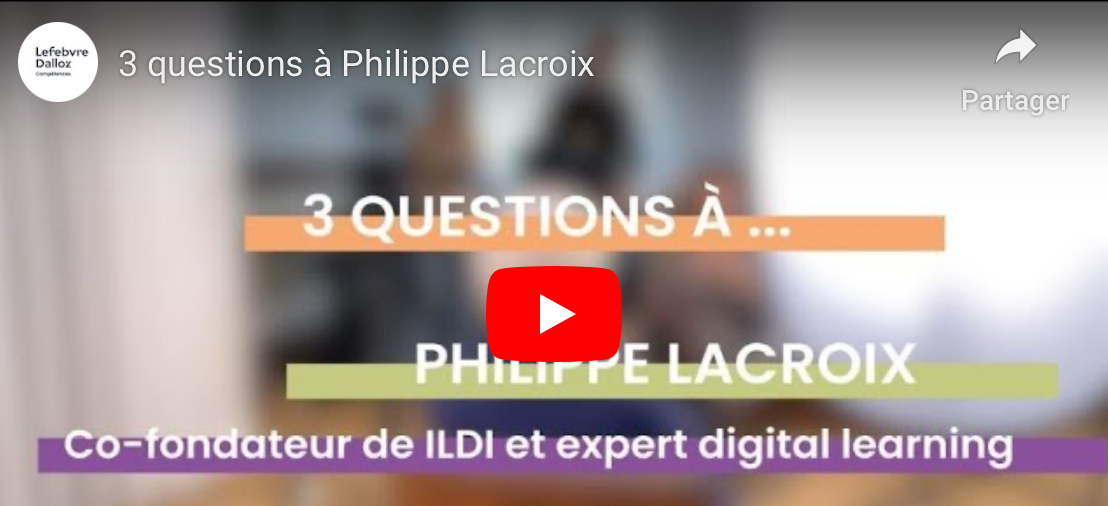Ultrasons focalisés : un nouvel outil non invasif pour soigner le cerveau avec précision
À l’heure actuelle, les pathologies cérébrales sont traitées soit par des médicaments, soit par des interventions chirurgicales. Mais une troisième voie semble s’ouvrir, grâce aux ultra-sons.

Dépression, douleurs chroniques, maladies de Parkinson et d’Alzheimer, troubles obsessionnels compulsifs… Autant de pathologies qui pourraient, dans un avenir plus ou moins proche, bénéficier de traitements par ultrasons focalisés. Retour sur une approche qui a le vent en poupe grâce aux progrès technologiques réalisés ces dernières décennies.
Imaginez : souffrant de dépression, vous ne ressentez plus rien d’autre que de l’incompréhension, du désespoir et de la souffrance, même face aux plus belles choses de l’existence. Les traitements médicamenteux sont lourds et peuvent durer des mois, sans garantie systématique de résultats, puisque jusqu’à un tiers des personnes dépressives ne répondent pas aux traitements couramment prescrits.
Imaginez encore : atteint de la maladie de Parkinson, il vous est difficile de bouger. Des traitements médicamenteux ont beau exister, plus vous en prenez, plus vous risquez d’augmenter l’ampleur des effets secondaires, qui se traduisent notamment par les mouvements involontaires anormaux et souvent saccadés (dyskinésies) caractéristiques de cette affection.
Ces situations sont représentatives de ce que vivent de nombreuses personnes atteintes de maladies du cerveau. Actuellement, les traitements sont de deux natures, médicamenteux ou chirurgicaux par (implantation d’électrodes).
Les premiers inondent le cerveau et causent le plus souvent de nombreux effets indésirables, comme par exemple l’insomnie, les troubles digestifs (nausées, vomissements) ou les troubles cognitifs (pertes de mémoire ou des fonctions exécutives). Les seconds sont, comme toute chirurgie, et à plus forte raison les chirurgies du cerveau, particulièrement risqués.
D’autres approches visant à modifier l’activité du cerveau sans chirurgie sont également explorées. Regroupées sous le terme de neuromodulation, elles sont soit électriques (diffusion d’un faible courant entre deux électrodes, soit magnétiques (bref changement du champ magnétique induisant une activité neuronale). Malheureusement, ces techniques ne sont capables d’atteindre que la partie superficielle du cerveau, avec une faible spécificité.
En revanche, le recours aux ultrasons pourrait changer la donne. Cette méthode permet en effet de cibler avec précision des zones profondes du cerveau. Explications.
Concentrer les ultrasons
Les sons correspondent à des vibrations se propageant dans l’air ou l’eau. Notre oreille est capable de les percevoir lorsque leur fréquence reste faible, entre 100 Hz et 150 Hz pour une voix masculine et entre 200 Hz et 300 Hz pour une voix féminine. Les ultrasons, qui correspondent à des vibrations dont la fréquence dépasse 20 kHz, ne sont en revanche plus perceptibles par l’oreille humaine.
Sur le plan médical, les ultrasons sont utilisés depuis des décennies pour réaliser des imageries de différentes parties du corps. L’un de leurs usages le plus connus est l’échographie, utilisée par exemple pour vérifier l’état de santé du fœtus et permettre aux futurs parents de distinguer les traits et mouvements de leur enfant à naître.
Les ultrasons générés par les appareils d’imagerie se propagent dans le corps, et entrent variablement en résonance avec les différents tissus, en fonction de leur densité. Ce sont ces résonances qui sont captées par les instruments, puis converties en images. On parle alors d’ultrasons de diagnostic.

Chaque mardi, notre newsletter « Et surtout la santé ! » vous donne les clés afin de prendre les meilleures décisions pour votre santé (sommeil, alimentation, psychologie, activité physique, nouveaux traitements…) !
La nouveauté des ultrasons focalisés repose sur l’orientation et la concentration temporelle des vibrations acoustiques et la quantité d’énergie déposée au même endroit. L’objectif est ici de les diffuser vers un même point. On peut comparer cette approche à celle qui consiste à focaliser les rayons du soleil avec une loupe : l’énergie s’accumule au point focal où ils se rejoignent. Cette approche ouvre de nouvelles perspectives.
Les scientifiques se sont ainsi aperçus qu’il était possible, en employant des ultrasons focalisés de haute intensité, de coaguler les tissus et d’éliminer des tumeurs à travers tout le corps. Cette approche, baptisée « échothérapie » est utilisée par exemple pour traiter les nodules thyroïdiens ou certaines tumeurs de la prostate ou du sein.
La renaissance de la neuromodulation par ultrasons
Dans les années 1960, certains chercheurs ont découvert que les ultrasons focalisés de basse intensité – c’est-à-dire avec des intensités proches de l’ultrason de diagnostic – pouvaient moduler l’activité cérébrale.
En entrant en relation avec le tissu cérébral, les ondes acoustiques accroissent en effet la pression locale (pression acoustique due aux ondes acoustiques), ce qui modifie temporairement le comportement des neurones. Si ce processus est répété, la communication entre certains neurones (circuit) change de manière plus permanente et permet au cerveau de se réorganiser.
La mise en œuvre de cette approche dans les années 1960 s’est heurtée à un obstacle de taille : le crâne, de par sa densité et sa forme, absorbe ou dissipe la majorité de l’énergie acoustique. Mettre en œuvre la neuromodulation par ultrasons nécessitait à l’époque de pratiquer une opération chirurgicale pour retirer une partie du crâne (craniotomie). Cette intervention étant particulièrement invasive, l’emploi des ultrasons focalisés pour agir sur le cerveau a été abandonné.
Mais les progrès technologiques de ces dernières décennies ont permis de dépasser cette limitation. D’une part, l’imagerie médicale permet désormais d’obtenir des clichés de haute résolution du crâne, et donc d’en connaître la densité. D’autre part, le développement des outils dits computationnels permet d’estimer la part d’énergie acoustique perdue à cause de l’os, et donc de la compenser.
Ces avancées rendent possible l’emploi précis et sûr des ultrasons transcrâniens chez l’être humain, ce qui explique le regain d’intérêt exponentiel que connaît cette technique depuis quelques années. Mais, malgré ces avancées, de nombreuses limitations subsistent.
Des limitations à dépasser
La première limitation est liée au fait que les ultrasons focalisés ne produisent pas d’effets directement observables, ce qui rend leur dosage difficile. Par mesure de sécurité (pour éviter de chauffer le tissu, ou d’avoir des risques de coagulation), des intensités très faibles sont choisies, ce qui limite probablement l’ampleur des effets observables.
Par ailleurs, le positionnement des appareils nécessite une haute précision, ce qui nécessite de nombreuses étapes de préparation, rendant cette approche complexe à mettre en place. Il existe en outre une très importante variabilité interindividuelle en termes de géométrie du crâne et d’organisation du cerveau (configuration et taille de certaines régions, organisation du circuit neuronal à cette région…).
Ainsi, la stimulation d’une même partie du cerveau chez deux individus, avec les mêmes paramètres, mène à des résultats différents, de par l’intensité acoustique qui traversera le crâne, mais également de la manière dont le cerveau va réagir.
Il existe également une variabilité intraindividuelle. Selon l’état du participant (par exemple, selon son état de fatigue ou de stress), la stimulation est susceptible d’induire des effets variables. Enfin, et comme pour tous traitements, des travaux de recherche devront être menés pour déterminer la part de l’effet placebo dans les résultats obtenus.
Néanmoins, une fois les limites dépassées, la stimulation par ultrasons focalisés revêt un important potentiel pour aider les personnes souffrant de maladies du cerveau.
Un potentiel considérable
Des études récentes menées dans de nombreux contextes cliniques ont permis d’obtenir des résultats prometteurs, qu’il s’agisse d’employer les ultrasons pour diminuer les symptômes liés à la dépression, réduire l’intensité de douleurs chroniques, atténuer certains troubles moteurs associés à la maladie de Parkinson ou améliorer le fonctionnement cognitif de patients souffrants de la maladie d’Alzheimer. Par ailleurs, des résultats préliminaires laissent penser que les personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs peuvent aussi en bénéficier.
Pour autant, ces descriptions de cas cliniques ou ces études menées sur de petits échantillons n’ont toujours pas permis d’accéder à une compréhension précise de la dose requise pour atteindre un effet biologique ou de mettre au point des protocoles précis.
En dépit des nombreuses incertitudes qui demeurent et des défis techniques qui restent encore à relever pour optimiser cette technologie, le potentiel de la neuromodulation par ultrasons focalisés suscite un réel engouement scientifique et médical. Ce secteur est en plein développement, et l’aboutissement des recherches en cours pourraient améliorer la situation de nombreux patients souffrant de troubles cérébraux.![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

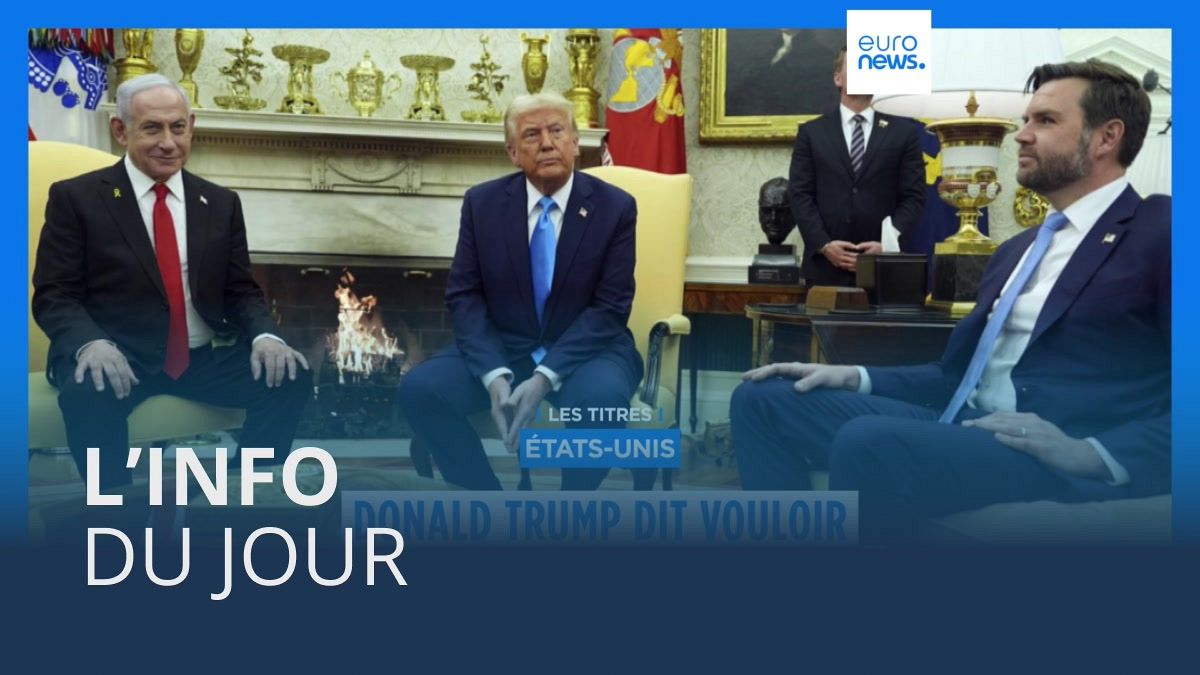



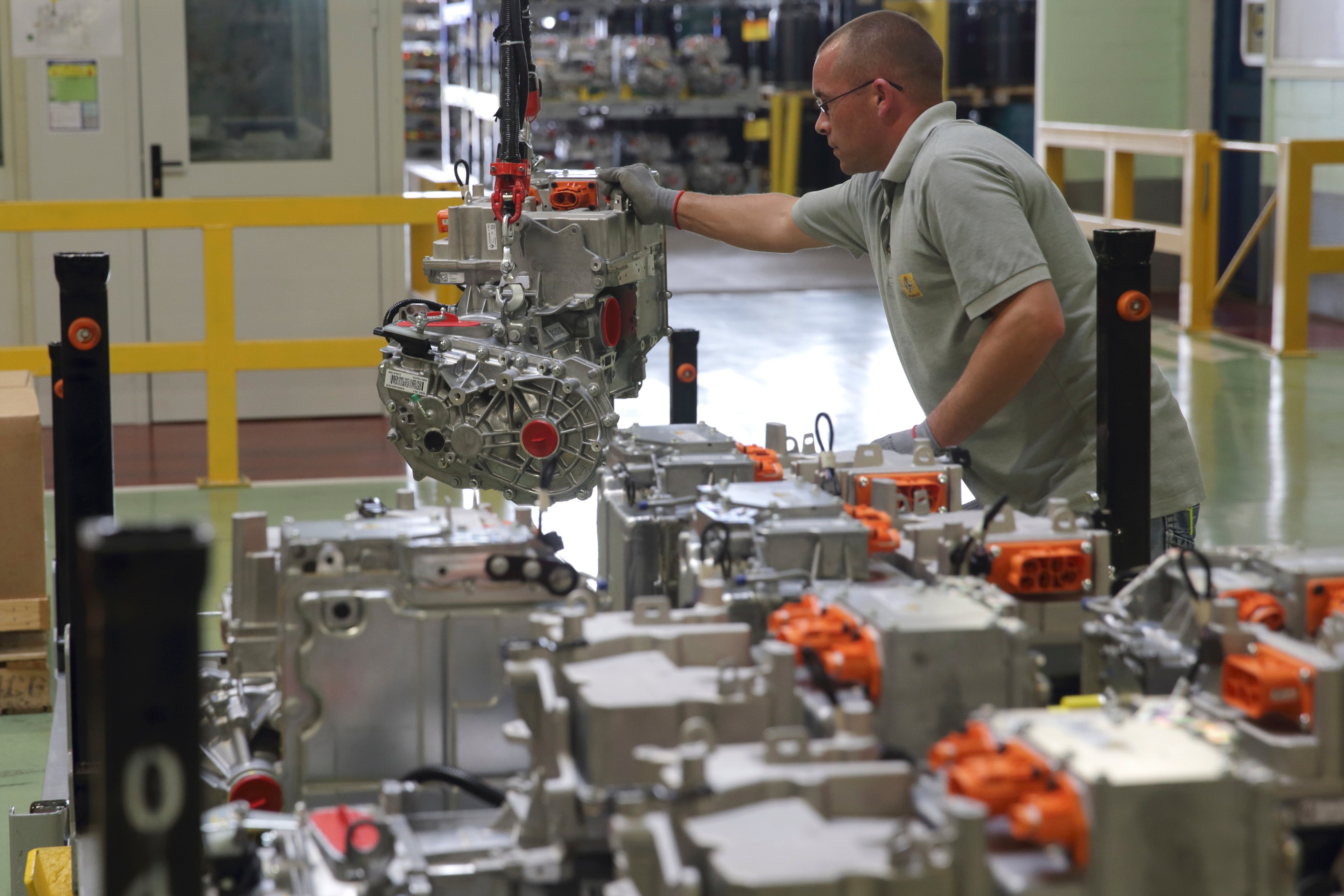



![[CHRONIQUE] Soixante ans de laxisme migratoire : le grand effacement ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/melenchon-616x346.png?#)















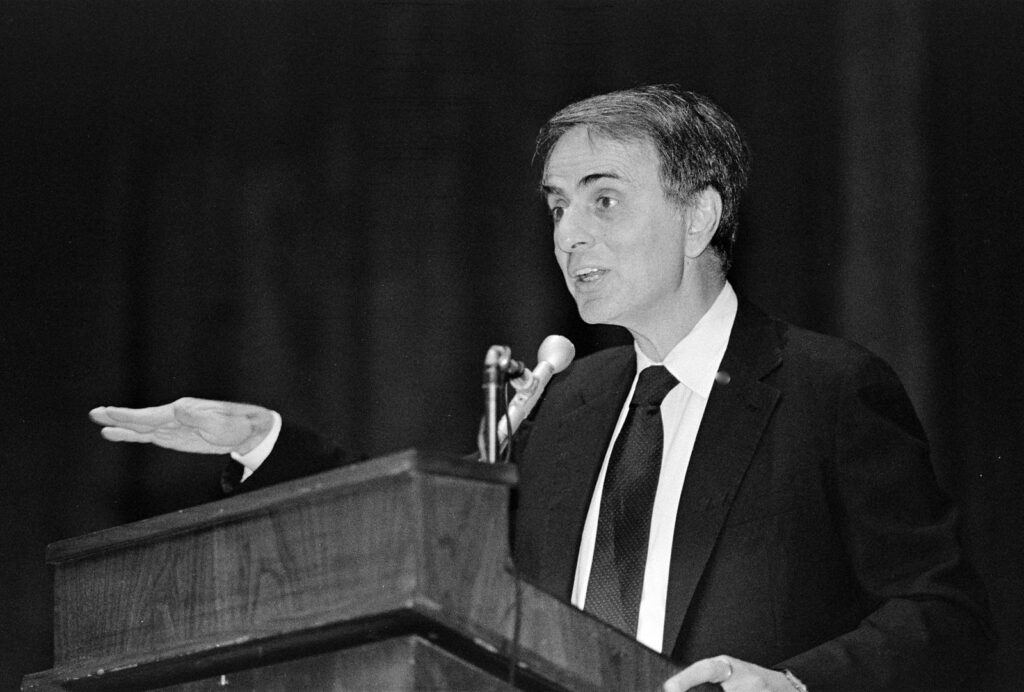



.jpg)







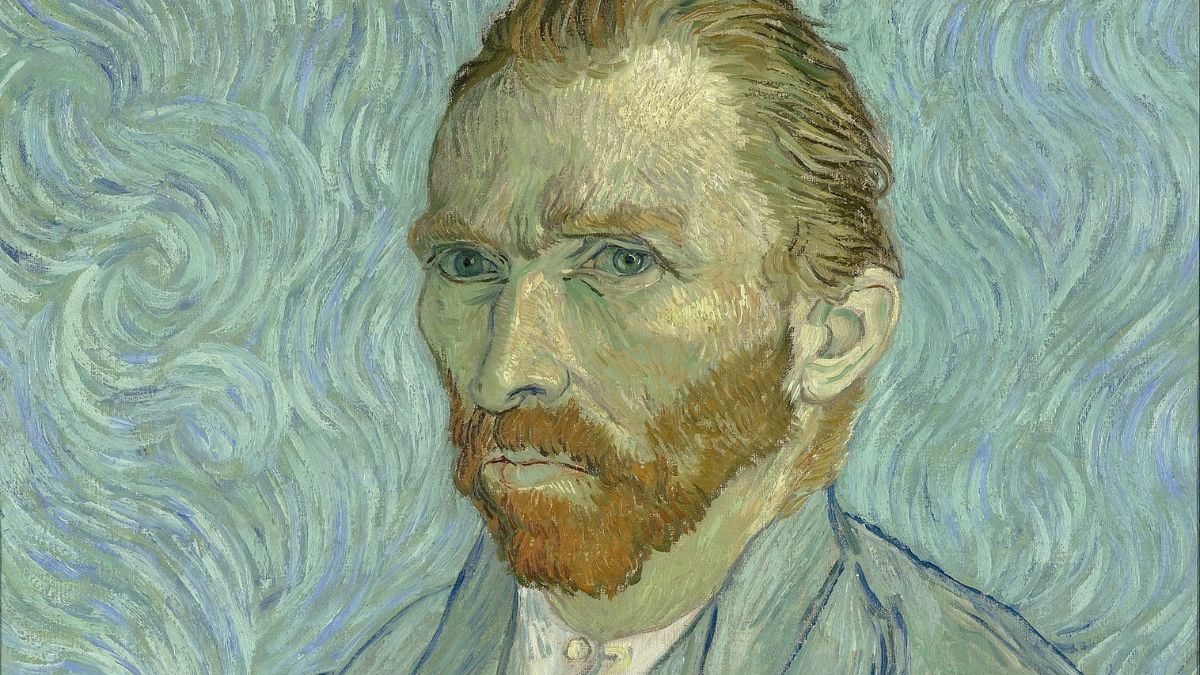
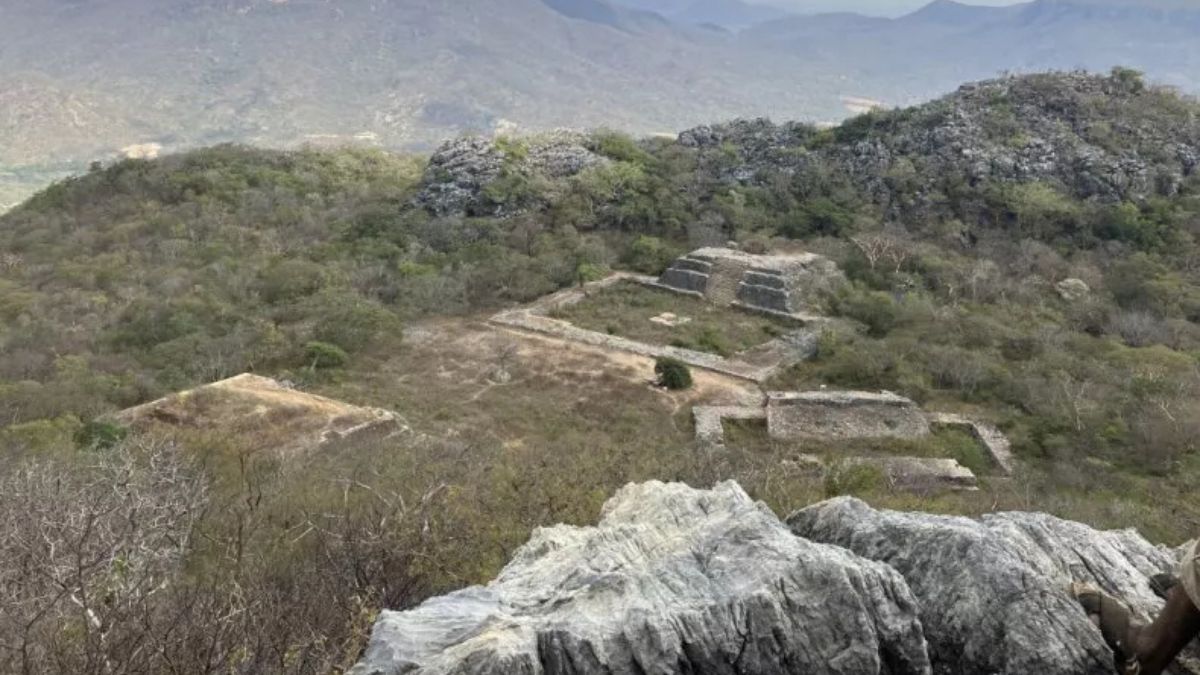








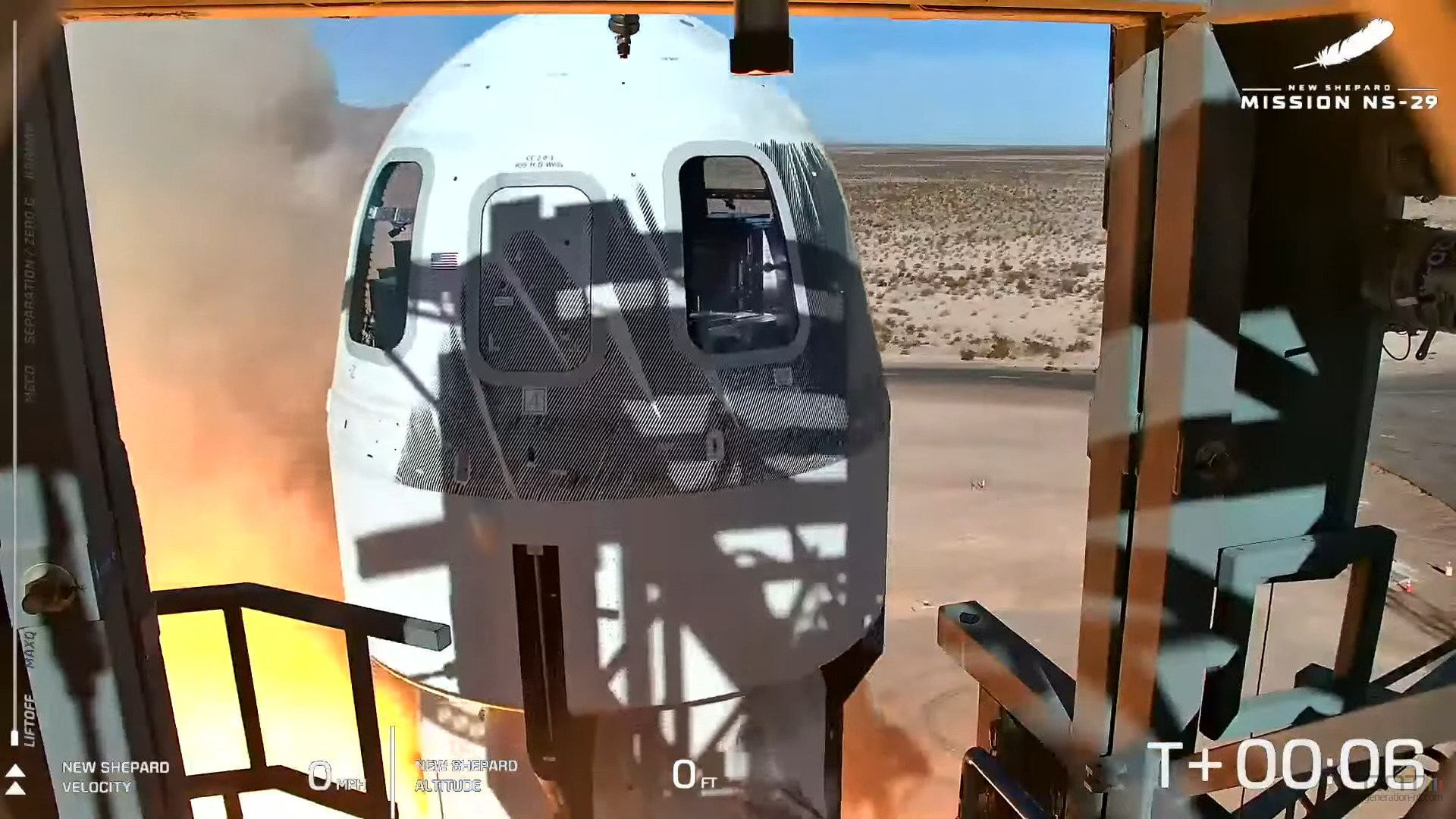

![« L’hydrogène européen commence à décrocher » [EY]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2023/07/5-1024x576.png)