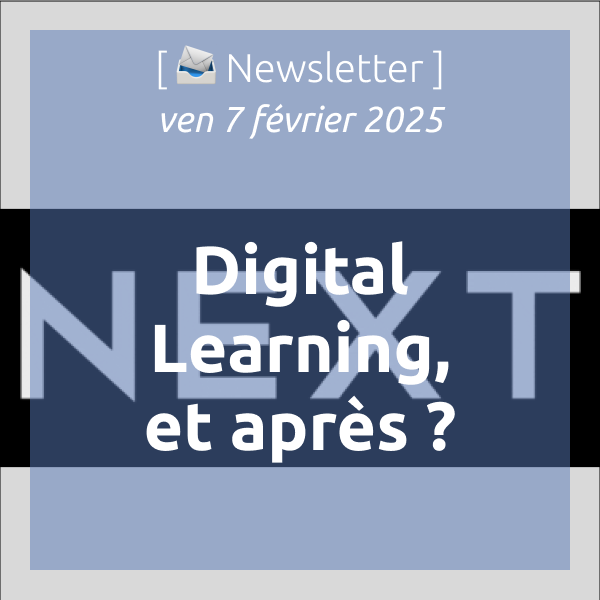Amanda Sthers: une saga familiale cosmopolite
2234095999 L’article Amanda Sthers: une saga familiale cosmopolite est apparu en premier sur Causeur.

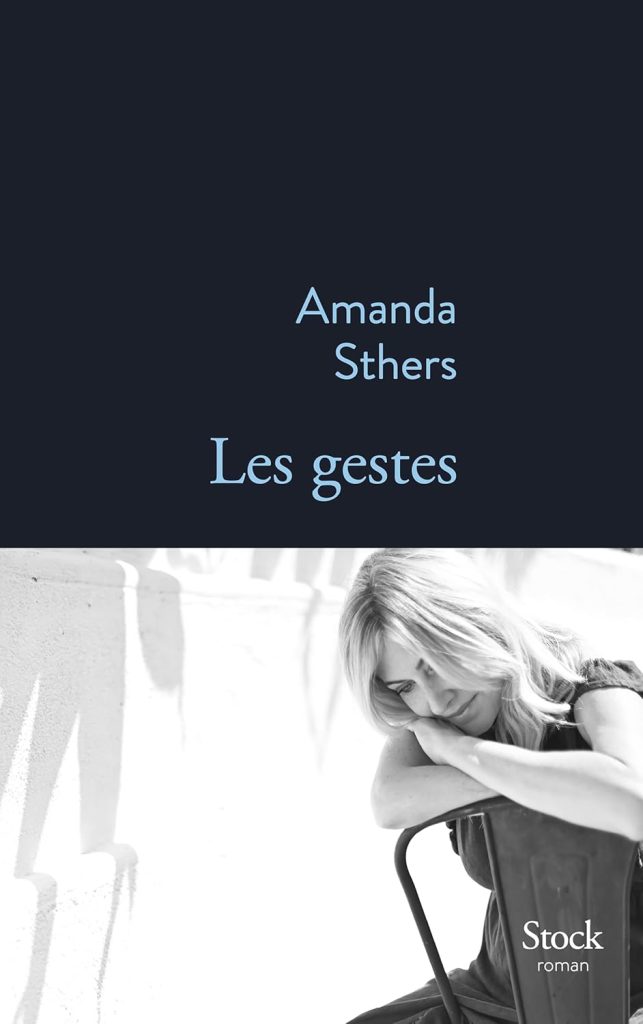
Amanda Sthers, romancière, cinéaste et auteur dramatique, entre autres, est née à Paris en 1978. Sa mère, une Bretonne, s’était convertie au judaïsme pour pouvoir épouser son père, le brillant psychiatre tunisien Guy Maruani. Je rappelle ces données familiales, car elles jouent un rôle important dans l’œuvre d’Amanda Sthers. En effet, c’est tout un univers juif séfarade qui baigne la plupart de ses fictions, inspirées, comme il se doit, de ses propres origines. Ici, avec Les Gestes, paru il y a peu, la romancière entreprend une saga familiale, transposée, il est vrai, en Égypte, pour être sûr de brouiller les pistes. La vérité se mérite, pour Amanda Sthers, dont les romans se veulent avant tout des interrogations sur la vie, sur l’identité des êtres humains, sur l’amour. Ces thèmes étaient déjà au cœur de sa célèbre pièce, devenue culte, Le Vieux Juif blonde, qui est rééditée aujourd’hui avec une préface inédite, et dont je note qu’elle est étudiée à Harvard, ce qui n’est pas rien.
Un roman de la transmission
La préoccupation principale des Gestes est peut-être celle de la transmission. Le narrateur, Marc, prend la plume pour expliquer à Camillo, un enfant sud-américain qu’il est sur le point d’adopter, dans quelle famille il entre. Il le prévient : « Je me demande si tu trouveras ta place ici, Camillo, toi qui vis au bord du fleuve Magdalena qui sépare les cordillères, dans un coin vert et chargé de bourdonnements d’insectes. » De fait, l’histoire de cette famille vaut le détour. Entre l’Égypte et la France, elle se déploie au rythme des rencontres, des mariages, des naissances. Le berceau des Ayoub est Alexandrie, mais ils ont de lointaines racines portugaises. Ils sont musulmans, ce qui n’empêche pas la grand-mère de Marc, Florentine, de recevoir une éducation catholique. À cette époque, en Égypte, toutes les confessions cohabitaient naturellement. La meilleure amie de Florentine, Rachel, est juive. Amanda Sthers ne néglige pas ce personnage, à propos duquel elle écrit : « Sa famille a émigré à Alexandrie au XVe siècle, ce sont des Juifs ibériques qui ont fui pendant l’Inquisition, installés dans le quartier de Souk el-Samak depuis des générations et complètement assimilés. » Ainsi, on voit évoluer un monde parfaitement bigarré, dans lequel Amanda Sthers semble tout particulièrement à l’aise.
A ne pas manquer, Causeur #131 Panique dans le camp du bien: la tech passe à droite
Une part autobiographique
Le destin de la famille se poursuivra ensuite en France, notamment avec Hippolyte, le fils unique de Florentine, qui deviendra archéologue après des études à la Sorbonne. Il retournera en Égypte à l’occasion de fouilles. Mais désormais la famille est implantée à Paris, un peu comme celle d’Amanda Sthers. Je suppose que la romancière a distillé dans ce livre beaucoup d’éléments qui lui sont propres. La Tunisie devient l’Égypte, pour satisfaire au principe du « mentir-vrai ». Ce faisant, une mise à distance est rendue possible, qui permet à la romancière un retour sur soi plus net, plus significatif. Grâce à l’Égypte en toile de fond de son roman, elle cerne mieux ses propres origines familiales, et comprend ce qu’elle doit à ses ancêtres de là-bas. Se sentant profondément juive, comme elle l’a déclaré souvent, Amanda Sthers a choisi de s’arrêter sur le côté paternel de sa généalogie intime. En tout cas, c’est ce que le lecteur peut conclure. Des explications précises, elle en donne. Ainsi, elle fait dire à son personnage Marc, au début : « Se préoccuper de l’origine des choses est une spécificité humaine. Ton grand-père [Marc s’adresse, je le rappelle, à Camillo] était archéologue, j’ai été élevé avec cette obsession d’hier ; à travers ce texte, je te la transmets et je t’en sauve également. » C’est avec de telles notations, tout en finesse, que le roman d’Amanda Sthers fait entrer le lecteur dans une vraie réflexion. La romancière écrit certes un roman, et même, pourrait-on, une sorte de saga (au sens anglais du terme). Mais il y a une pensée, derrière ce qu’elle raconte, et même une philosophie. Elle cherche un sens à tout ça.
Les corps conducteurs
Le destinataire de ce texte que nous lisons, le petit Camillo, va devenir membre à part entière de cette famille-continent, dont il devra certes apprendre les usages, mais pas seulement : la morale, aussi. Je suis frappé, chez beaucoup de romanciers contemporains, par ce désir d’éthique qui renaît chez eux, après une période de relativisme hérité des terribles années 70. Sur ce plan, Les Gestes est une vraie réussite littéraire, avec des personnages doués de sens moral, et qui tentent, sans toujours y parvenir, d’agir avec discernement pour, peut-être, choisir la vie qui leur convient, une vie tournée vers les autres. Car, comme tout roman peu ou prou mené à son terme, Les Gestes est avant tout une grande histoire d’amour entre les êtres humains, ce que Claude Simon avait illustré jadis par la formule géniale du titre d’un de ses romans : Les Corps conducteurs (1971). Les personnages d’Amanda Sthers, eux aussi, sont des corps conducteurs…
Amanda Sthers, Les Gestes. Éd. Stock.
Du même auteur, une réédition, Le Vieux Juif blonde. Préface inédite. Grasset.
L’article Amanda Sthers: une saga familiale cosmopolite est apparu en premier sur Causeur.









![[LE CROC D’IXÈNE] Il faut trouver un autre nom au quartier de la Négresse](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/bv78-biarritz-ne-gresse-vign-516x482.jpg?#)


















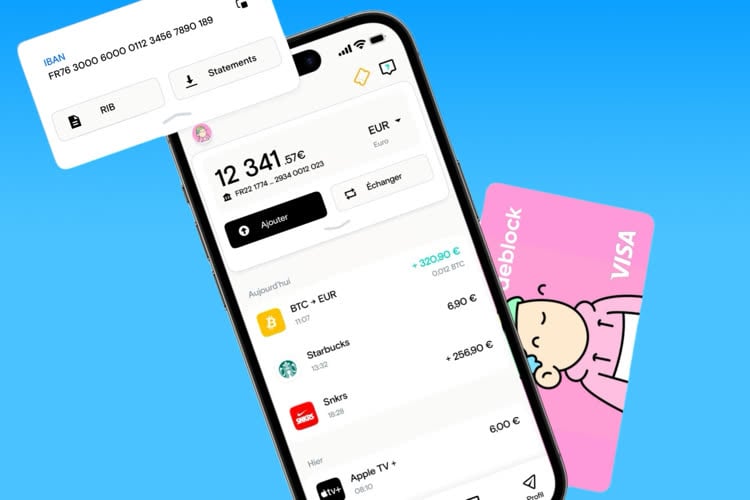






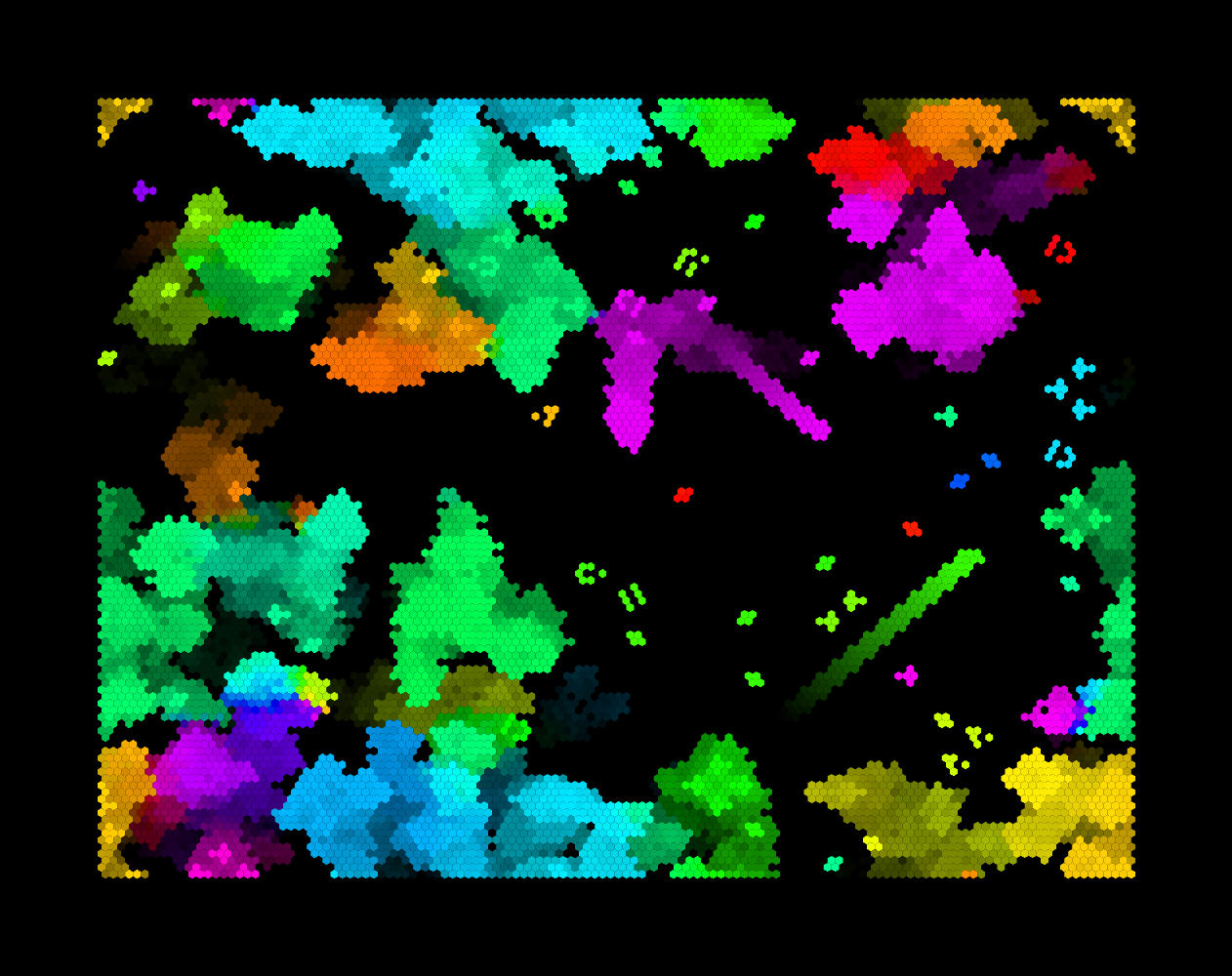

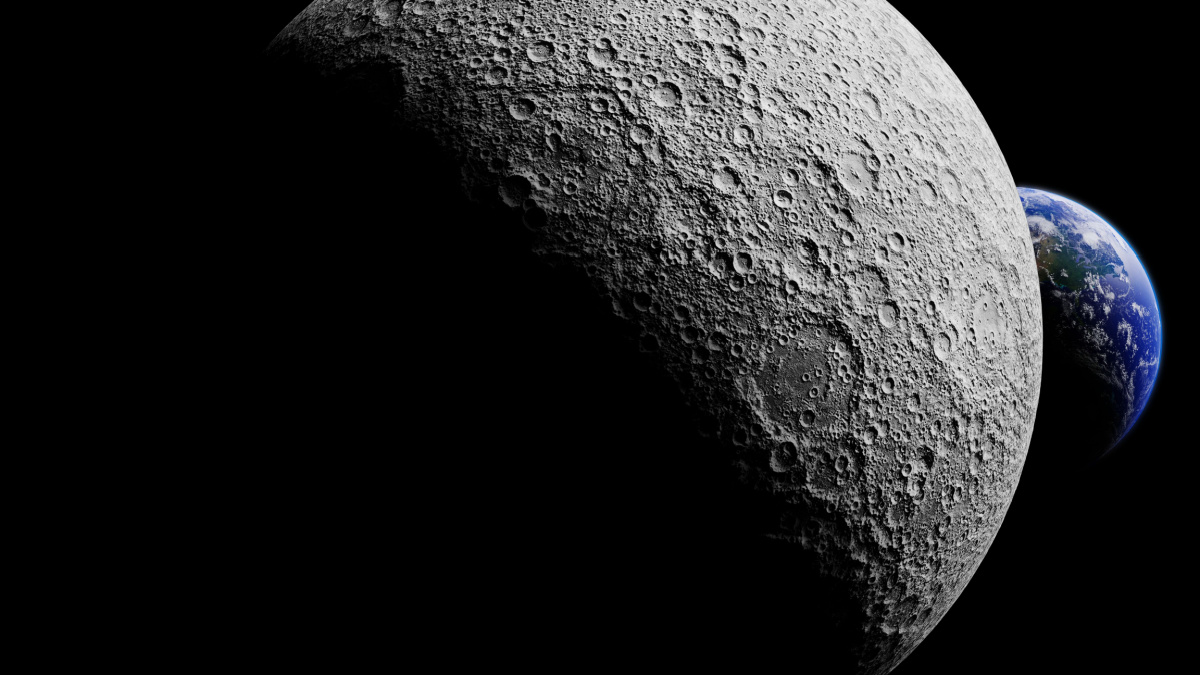
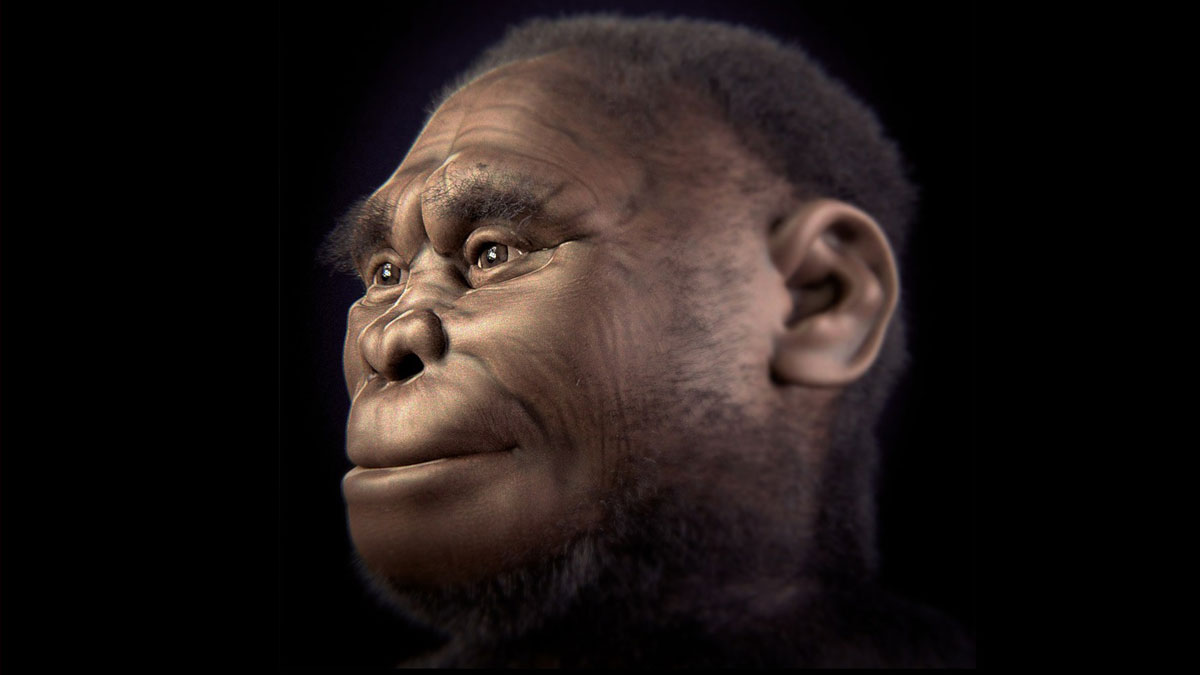
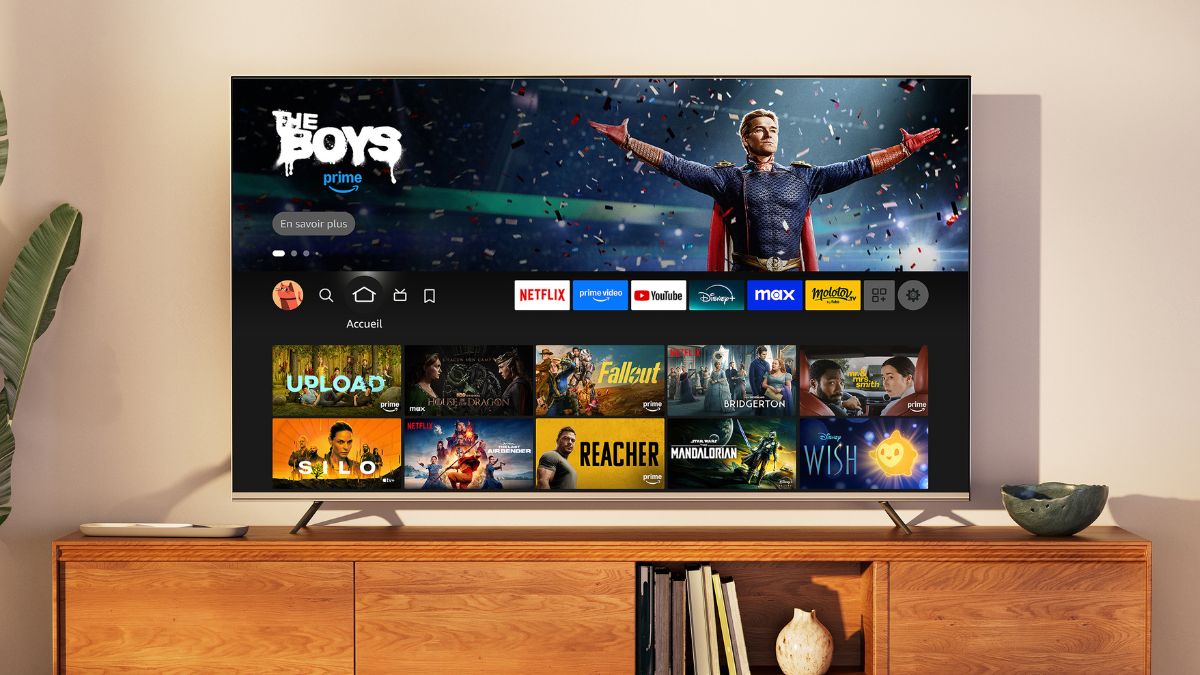






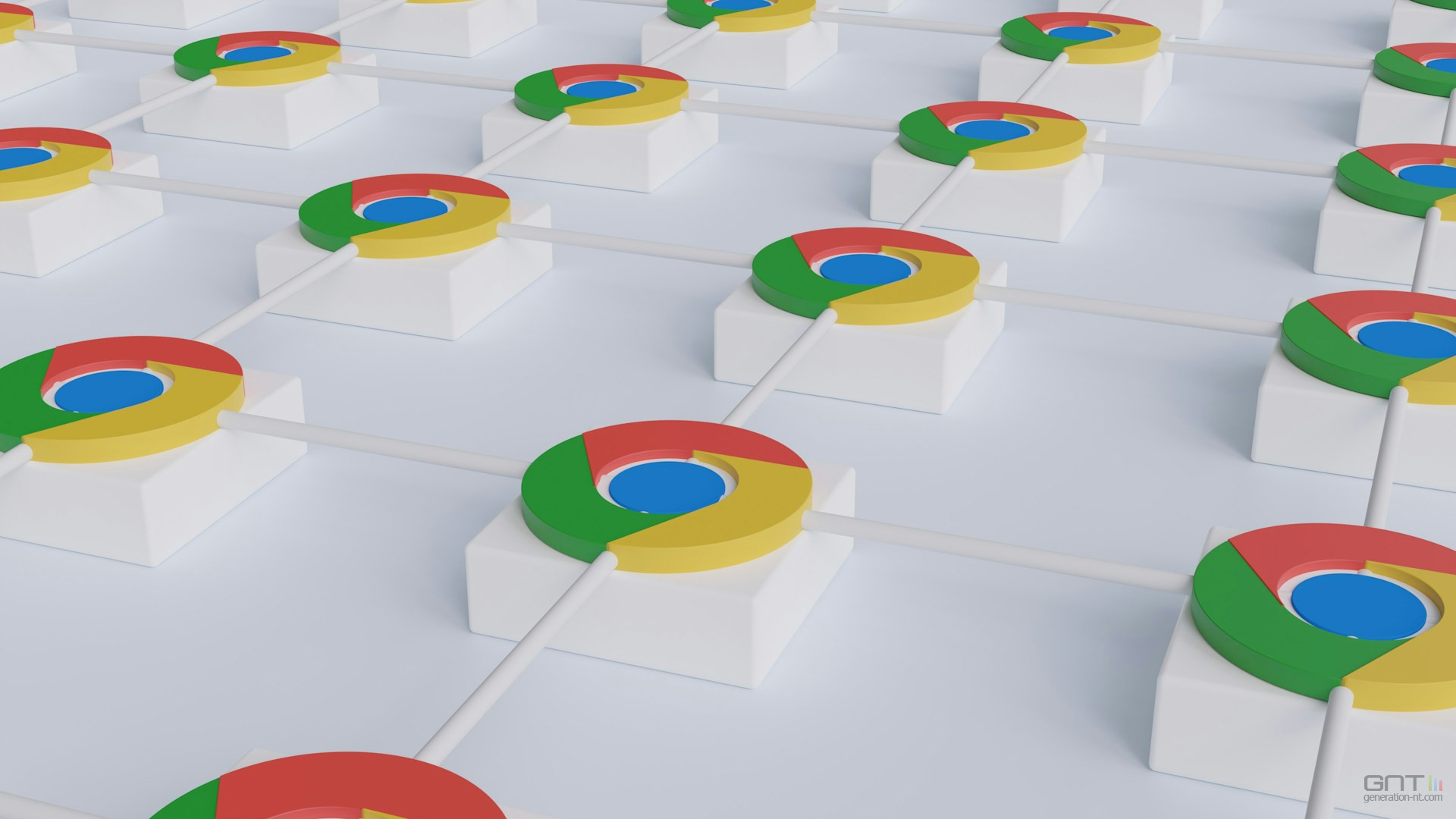










/image%2F0535633%2F20240125%2Fob_e59049_oig-8hjrzz8oexhwvlgsi.jpg)